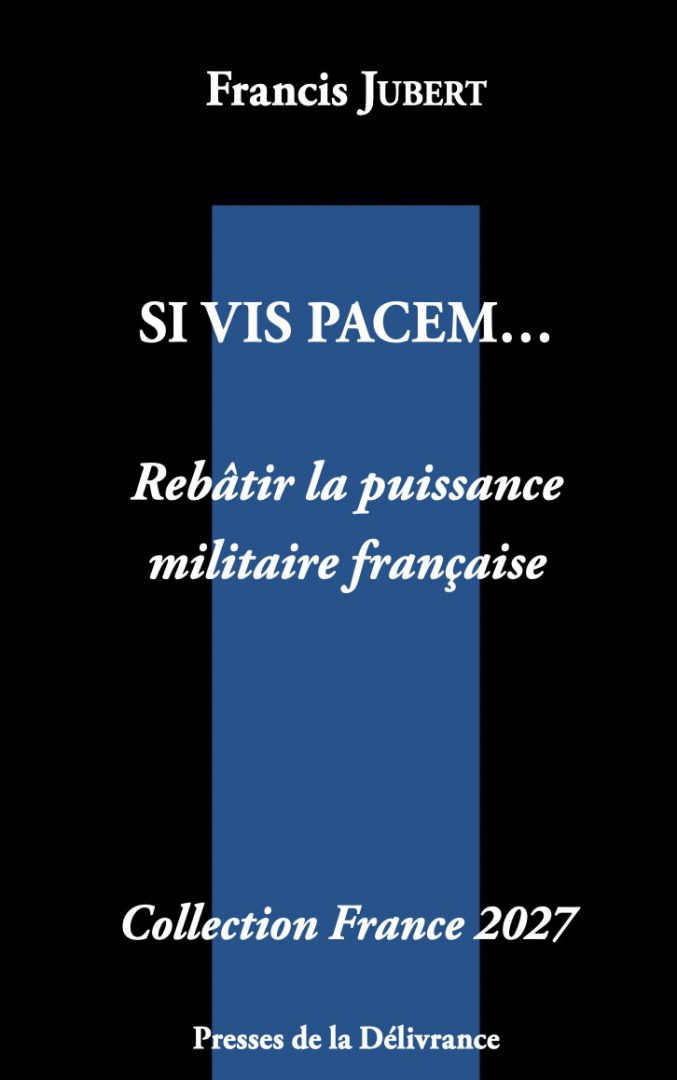Avec Si vis pacem, Francis Jubert publie un ouvrage d’une rare cohérence intellectuelle, où se conjuguent réflexion humaine, culture militaire et analyse stratégique rigoureuse. Le livre, salué dès ses épreuves par plusieurs officiers généraux, s’inscrit dans la tradition française d’une pensée militaire nourrie à la fois de l’expérience vécue, de la mémoire historique et de la lucidité politique.
Un auteur héritier d’une tradition militaire, qui parle de l’intérieur
L’itinéraire de l’auteur éclaire la tonalité de l’ouvrage. Fils d’officier, petit-fils d’officier, officier de réserve lui-même, Francis Jubert est un homme pour qui le mot servirn’est ni un slogan ni un mythe, mais une expérience vécue et transmise. Il évoque aussi la figure de son grand-oncle, l’avocat Raymond Jubert, auteur d’un magnifique Verdun préfacé par Paul Bourget, tombé au champ d’honneur. Ce rappel n’est pas une mise en scène : c’est l’expression d’une continuité familiale et morale qui irrigue chaque page du livre.
Un livre pour éviter l’hécatombe : la paix comme devoir de préparation
L’auteur l’écrit explicitement : il a rédigé Si vis pacem « pour éviter pareille hécatombe ». Rien de martial dans cette démarche. Francis Jubert rappelle au contraire une vérité trop souvent oubliée : la paix n’est jamais garantie. Elle se prépare. Elle exige une maturité morale, un effort politique, une crédibilité militaire et une base industrielle solide.
Son texte explore ainsi, avec une grande justesse, les liens étroits entre :
- la cohésion d’un peuple et la résilience stratégique ;
- la capacité industrielle et la crédibilité opérationnelle ;
- la lucidité politique et la possibilité même de la paix.
C’est ce croisement entre anthropologie, stratégie et économie qui donne au livre sa profondeur singulière.
Une analyse technique solide, ancrée dans la comparaison internationale
L’un des aspects les plus appréciés par les officiers généraux qui ont pris connaissance du manuscrit est la rigueur de l’analyse. L’auteur compare, chiffre, met en perspective. Il examine :
- le modèle britannique, agile mais dépendant, structuré par une culture politico-militaire particulière ;
- le cas allemand, marqué par une inertie bureaucratique que le Zeitenwende n’a que partiellement corrigée ;
- le modèle français, dont il détaille les faiblesses : stocks insuffisants, cadences industrielles faibles, dépendances critiques, sous-investissement chronique, rigidités doctrinales.
Cette partie technique, particulièrement bien maîtrisée, fournit au lecteur une image claire des vulnérabilités françaises et des marges de manœuvre réalistes.
Une actualité brûlante : posture politique et instrumentalisation du commandement
Les déclarations du nouveau CEMA, le général Landon, prennent une résonance particulière dans un contexte politique tendu : le Président Macron, dont la légitimité est de plus en plus contestée — avec seulement 11 % d’opinions favorables — cherche à se construire un nouvel horizon politique. Pour ce faire, il met en avant la gravité et l’imminence supposée d’une menace militaire, instrumentalisant le chef d’état-major des Armées et l’exposant à la critique.
Francis Jubert ne conteste pas, bien au contraire, la nécessité d’une préparation militaire et morale de la nation— la paix exige toujours vigilance et cohérence — mais s’insurge contre le fait que les plus hautes autorités militaires soient utilisées comme relais d’une mise en scène politique. Une telle stratégie brouille la frontière entre la vérité stratégique, que le chef d’état-major des Armées ⁷doit dire, et l’instrumentalisation politique, qui ne vise qu’à créer un horizon pour le pouvoir exécutif.
Le message est clair : la France ne se prépare pas en simulant la menace, mais en construisant des capacités réelles, en formant ses hommes et en maintenant une industrie de défense robuste. Tout le reste n’est que communication, au risque de fragiliser la confiance dans nos institutions militaires et de détourner l’attention des véritables priorités stratégiques.
Une consonance avec la pensée du général Pierre de Villiers
Cette exigence fait écho à la position défendue par le général Pierre de Villiers lors de son allocution à la Clairière de l’Armistice de Compiègne : il y rappelait, le 11 novembre, que la France doit adapter son modèle d’armée pour regagner en effectifs, équipements, logistique, munitions et entraînement, et affirmait la nécessité de défendre l’autonomie stratégique nationale, non par repli, mais par une véritable indépendance de jugement, de décision et d’action.
Or, l’autonomie stratégique est précisément le cœur de Si vis pacem. Francis Jubert en fait la condition de toute protection nationale et l’axe autour duquel la France doit rebâtir sa puissance militaire.
Conclusion — Un livre qui clarifie, alerte et propose
Si vis pacem n’est ni un pamphlet, ni un manifeste d’humeur. C’est un texte de fond, rédigé par un homme qui connaît la réalité humaine du service et les contraintes techniques de la défense.
Il s’inscrit pleinement dans l’analyse du général Christophe Gomart, qui refuse l’illusion d’un « marché unique de la défense » européen qui sacrifierait l’autonomie stratégique sur l’autel du libre-échange industriel. Francis Jubert y trouve l’un de ses appuis les plus pertinents : la défense n’est pas un marché, mais un attribut de souveraineté.
Enfin, l’ouvrage résonne fortement avec les propos récents de l’amiral Jean Dufourcq devant l’IHEDN, rappelant que l’ombre portée de la dissuasion nucléaire française demeure « la clé de la sécurité de la France » et un pilier de stabilité pour l’Europe. Sans elle, aucune autonomie stratégique n’est crédible.
Francis Jubert offre ainsi un texte essentiel qui permet de clarifier le débat national : un appel à la lucidité, à la continuité historique, à la reconstruction industrielle et à la vérité stratégique. Un livre pour rappeler que la paix n’est jamais un acquis, mais une responsabilité qui engage toute la nation.
Pour télécharger « Si vis pacem », cliquez ici.