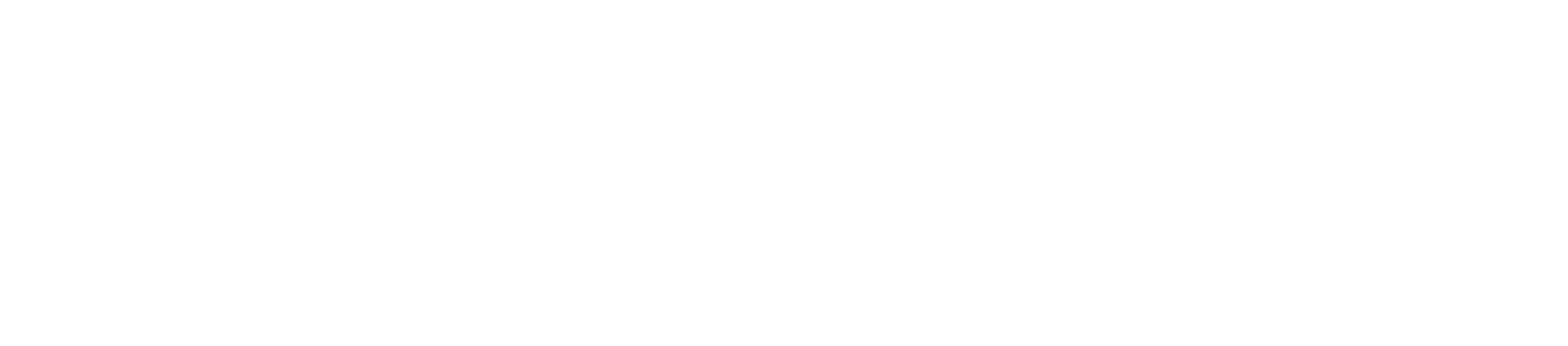Par Jean-Frédéric Poisson
Voilà des avis de décès qu’on a rarement autant diffusés et qui ont rarement autant réjoui : il paraît que la droite et la gauche seraient mortes. C’en serait fini de ces deux catégories politiques, ancrées dans la vie institutionnelle, de manière formelle, depuis la révolution française, et dont la fortune est universelle. Elle permet en effet de se repérer dans à peu près tous les contextes politiques – du moins là où le pluralisme des partis existe. En France, particulièrement, l’arrivée aux affaires du macronisme flamboyant s’était accompagnée de cet argument décisif: «Je balaye, disait le président français, l’ancien monde, la gauche et la droite, les conservateurs et les progressistes, et j’invente quelque chose de nouveau ». À vrai dire, on attend encore le début du commencement de cette invention. On a même pu se rendre compte qu’en fait de nouveau, le chef de l’État et son parti politique avaient rapidement adopté les vieilles manies: devenus vieux avant d’avoir été jeunes, en quelque sorte.
En réalité, prétendre que ces catégories sont désuètes est beaucoup trop rapide. On a beau dire et répéter à l’envi qu’il n’y a plus de différence réelle entre la gauche et la droite politiques, l’emploi de ces catégories est encore massif et toutes deux sont une aide puissante pour permettre aux électeurs de se repérer et de décider. Ces catégories n’ont en fait jamais été remplacées, parce qu’on ne remplace bien que ce que l’on supprime. Ce n’est pas faute que les partis politiques et leurs dirigeants y aient donné du leur. Si l’impression selon laquelle «la droite et la gauche, c’est du pareil au même» est vraisemblable ou seulement crédible, c’est bien que ces mêmes partis et dirigeants ont abandonné, avec une énergie et souvent une couardise considérables, quelques-uns des principes fondateurs qui ont établi les positions politiques droitière et gauchère et renforcé leurs doctrines politiques de référence.
Il serait très ambitieux, voire imprudent, de qualifier les partis de droite actuellement aux affaires de « conservateurs ».
Il serait en effet très ambitieux, pour ne pas dire imprudent, de qualifier les partis de droite actuellement aux affaires de « conservateurs». Si l’on accepte que le conservatisme est fondé sur cette idée simple, selon laquelle la nature nous enseigne qu’il y a un bien et un mal et qu’on doit faire le bien et éviter le mal en morale comme politique, alors aucun des dirigeants actuels des partis ne mérite cet adjectif. On constate même chez ces partis une énergie à vouloir à tout prix s’en débarrasser, de peur que, comme un mauvais poisson d’avril, ils ne se fassent accrocher cette étiquette dans le dos sans s’en rendre compte.
Quant à la gauche, elle avait fondé sa fortune sur l’idée d’un progrès collectif de l’humanité, assis sur le sérieux de la science, destiné à contrer l’obscurantisme religieux. Mais le logiciel gauchiste a été vérolé, comme l’on disait jadis. L’individualisme libéral du tout désir a tué le collectif et les institutions. Une science au rabais nourrit le radicalisme écologique en préférant les collectifs fumeux au sérieux académique. Et on chercherait en vain quelque lumière que ce soit dans la soumission à l’islam conquérant.
La mission de la droite consiste à conserver les invariants de la vie sociale.
Alors, comme une bouée de sauvetage, il restait l’État. C’est-à-dire le débat ancien sur la manière dont il doit intervenir dans la vie sociale et publique et, par conséquent, l’équilibre entre l’autorité de l’institution et le respect des libertés individuelles. La guerre froide et ses remugles ont pu éventuellement permettre de jeter le manteau de Noé sur les deux faillites des droites et des gauches. Puisqu’il n’était plus question d’histoire ni d’humanité, elles s’étaient concentrées sur l’économie: la droite serait libérale et la gauche socialiste. Et voilà maintenu, au moins pour un temps, le clivage droite-gauche et avec lui, de quoi justifier l’existence des formations politiques qui s’en réclament.
C’était sans compter sur le fait que la droite pourrait à son tour être droguée à la dépense publique et à l’individualisme forcené, au point de rendre inopérante toute forme de désintoxication et d’oublier les obligations liées à notre héritage culturel. Et sans compter non plus sur le fait que la gauche se convertisse à l’économie sauvage de marché au point de porter, en étant aux responsabilités, l’Acte unique de 1986, le Traité de Maastricht et la création de l’euro: sans aucun doute le plus beau bilan libéral de l’après-De Gaulle! Pas étonnant que des «frondeurs» souhaitant rester fidèles à leur héritage aient nourri, sous le mandat suivant de la gauche (celui de François Hollande), des oppositions internes si fortes qu’elles ont privé le président sortant de la possibilité même de concourir à sa réélection.
C’était sans compter non plus sur la résistance des peuples. Même si cette réalité n’est pas très visible en France – encore que… – il faut probablement voir dans ce que les observateurs appellent l’émergence d’un «populisme» mondialement répandu, l’attachement viscéral, peut-être même instinctif, à la nation comme communauté naturelle. C’est comme si le délire de la mondialisation tous azimuts restituait dans l’esprit des peuples cette conviction que la nation est une communauté naturelle et que, par conséquent, en la détruisant, on esquinte de manière irréparable la possibilité même de construire un bien commun. Nos économies n’ont pas su pour le moment résister à la concurrence des systèmes de production. Il semble qu’au contraire nos esprits n’aient pas encore été définitivement victimes de la concurrence des systèmes de valeurs.
Revenons à l’instant à cette période de notre vie politique pendant laquelle la droite et la gauche étaient encore des repères parlants. Le contexte dans lequel se déroulait le débat public était intellectuellement stable. Il n’y avait guère de doute sur le fait que l’indépendance de la France était la condition sans laquelle rien ne pouvait se faire chez nous; ni sur le fait que la stabilité institutionnelle était la première vraie garantie des libertés, individuelle comme collective; ni sur le fait que la cellule familiale et sa solidité devaient être préservées à tout prix, comme le lieu privilégié de tous les apprentissages nécessaires à la vie sociale; ni sur le fait que la liberté individuelle et la responsabilité devaient s’accomplir dans un ordre public garanti, par conséquent contraignant autant que protecteur.
Dans un tel contexte, la mission de la droite consistait à conserver ces différents éléments constitutifs de la vie sociale considérés comme des invariants. Et cette mission était elle-même, de fait, invariante. Dès lors, la seule question posée aux partis politiques droitiers n’était pas «que faire?», mais «quel chef nommer pour le faire?». Inversement, la gauche qui s’était donné comme mission de faire progresser l’humanité commençait par se demander comment faire évoluer ces invariants dans le sens d’un progrès social plus largement partagé. Elle se posait donc d’abord la question «que faire?», puis ensuite – et seulement ensuite – la question, «quelle personne idoine pour conduire un tel projet?».
La droite reste obsédée par une seule question: qui est le chef?
Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui? Ce n’est pas la logique de la gauche, qui de toute façon trouvera toujours matière à s’interroger sur les progrès qu’il convient de faire faire à la société. Elle continue donc de se poser ces deux mêmes questions dans ce même ordre. La logique de la droite n’a pas changé non plus. Elle est toujours gouvernée avant tout par l’obsession de la désignation du chef. Mais cette logique ne tient plus. Ce que les conservateurs entendaient conserver, ces invariants sur lesquelles la vie sociale doit être fondée, ne sont plus des invariants dans l’esprit des dirigeants et ne le sont que confusément dans l’esprit des peuples.
Trouvera-t-on le propos sévère? Mais la droite française n’a-t-elle pas activement participé au creusement de la dette publique depuis 50 ans au mépris de sa prétendue habileté de gestion, et, au fond, par paresse autant que par lâcheté? La droite française (une partie au moins) n’est-elle pas, ces jours-ci, en train de faire adopter par le Parlement la législation la plus permissive du monde sur l’euthanasie? N’a-t-elle pas finalement accepté l’idée du mariage homosexuel et renoncé à le retirer de la législation? N’at-elle pas bradé largement la souveraineté nationale à des institutions européennes qui ont détruit notre indépendance? N’a-t-elle pas laissé, non seulement sans rien dire, mais en étant complice, l’islam conquérant investir notre pays? N’a-telle pas refusé que soit inscrite dans la constitution européenne la référence à nos racines chrétiennes? N’a-t-elle pas refusé d’adopter des politiques natalistes énergiques pour prévenir ou au moins contrecarrer l’hiver démographique qui est en train de s’installer? N’a-t-elle pas laissé s’instaurer un pouvoir des juges qui surplombe l’autorité des pouvoirs exécutif et législatif, au point de menacer la séparation des pouvoirs? N’a-t-elle pas laissé dériver notre système éducatif et universitaire au point d’en faire, comme on a pu l’écrire, une «fabrique de crétins»?
Ce nécessaire bouleversement culturel de la Droite consiste d’abord à raisonner comme un médecin urgentiste, en posant le bon diagnostic.
La liste serait encore longue. Mais voilà au moins qui pourrait constituer, à rebours, un excellent point de départ pour redonner à la droite fran – çaise – et bien au-delà à toutes les personnes de bonne volonté et attachées à la France – tout autant des raisons d’espérer qu’un authentique programme de travail. Mais voilà l’ennui : la droite n’est jamais sortie de son obsession de savoir avant tout qui est le chef avant de se demander dans quel état se trouve le corps social et quel bien commun on peut lui construire (des esprits taquins diraient : en fait avant que chaque responsable de parti politique puisse savoir si le chef désigné est assez digne pour qu’on le rejoigne…). Cependant, jamais les électeurs de droite dans leur ensemble, n’ont été aussi demandeurs d’un grand rassemblement, prenant à bras-le-corps ces différentes questions et affichant le courage de s’y atteler en vérité et énergiquement. Et jamais les responsables politiques des partis censés représenter des Français n’ont été aussi éloignés de ce grand rassemblement.
Les Français le savent. Ou plutôt, ils en ont une forme d’intuition: seules des questions de préséance et de préservation des différentes chapelles expliquent cette réticence à mettre en œuvre cette union. Évidemment, la dizaine de partis politiques concernés (de toutes histoires et de toutes tailles) ne sont pas sans entretenir un certain nombre de nuances: c’est d’ailleurs plus que légitime. Mais la France est à reconstruire. Elle est dans la situation d’un grand accidenté de la route sur le bord de la chaussée: elle a besoin de mesures d’urgence et peu nombreuses. Certainement pas d’un catalogue rempli de réformes que personne n’engagera et dont personne ne comprend la cohérence.
Au-delà des situations personnelles, c’est à une question d’ordre culturel que nous sommes confrontés: les partis politiques de droite ou assimilés doivent impérativement réussir maintenant ce que la gauche française a accompli dans les années 1970: un programme commun de gouvernement. Nos lecteurs les plus anciens, non moins que les plus avertis, ont en tête que faire signer dans les années 1970 un document de programme commun par toute la gauche, depuis les radicaux de gauche, jusqu’au plus staliniens des leaders du parti communiste, n’était pas une chose facile! Qui prétendra qu’il n’y avait entre eux pas davantage de différences qu’il n’y en a entre les différentes formations de la droite française d’aujourd’hui? La gauche a fait la démonstration, mais c’est bien dans son esprit, que les différences de conviction ne sont pas un obstacle à la coopération politique (elle l’a du reste, encore récemment, démontré). Encore moins lorsque l’urgence rend nécessaire cette coopération. Il ne reste, à défaut de devoir adopter ses idées, qu’à imiter la méthode.
Malheureusement, « on » reprend espoir… Les uns, parce que le nouveau président élu des Républicains affiche une volonté conservatrice dont il y a peu de précédents – mais dans le même temps, son parti s’apprête à passer, dans un grand nombre de départements, des accords massifs avec la macronie dans la perspective des élections municipales… Madame le porte-parole du gouvernement disait, il y a quelques jours que le macronisme n’avait plus que quelques mois à vivre: est-ce une raison suffisante pour en assurer la survie par le biais de tels accords électoraux ?
Le Rassemblement National, quant à lui, surveille comme la sœur Anne depuis son clocher l’arrivée gourmande de l’élection législative à la proportionnelle. En ne voyant pas que cette modification du code électoral n’a qu’un seul but: maintenir le RN dans l’opposition! Ne comptons pas sur la fameuse prime majoritaire (qui garantirait la majorité des sièges à la formation arrivée en tête): elle est politiquement inimaginable et constitutionnellement très douteuse. De plus, personne, à part le RN évidemment, ne souhaite la mettre en place…
Les deux principales formations politiques de «droite» (sous bénéfice d’inventaire toutefois) de notre pays comptent donc encore sur les vieilles recettes pour y parvenir: les accords politiques pour les uns, la modification de la règle électorale pour les autres… Tout se présente comme s’ils n’avaient pas pris la mesure du bouleversement culturel qu’ils ont la responsabilité d’opérer en le rendant possible et en l’initiant. Ce bouleversement est double. Il consiste d’abord à raisonner comme un médecin urgentiste plutôt que comme un directeur de centre aéré: choisir un petit nombre de priorités plutôt que d’être obsédé par le maintien, coûte que coûte, d’un système à bout de souffle ou par la volonté d’y entrer enfin. Il consiste ensuite à accepter cette idée que ce sont les partis politiques, en raison même du rôle que leur confère la constitution, qui ont la responsabilité le démontrer au peuple qu’ils ont la volonté de se rassembler: «Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage» (Constitution de la Ve République, art. 4)1 .
N’ayons aucune illusion: ce genre de bouleversement culturel ne s’opère pas entre deux tours d’élection présidentielle. Il se prépare. Il se peaufine. Il se négocie longuement. Il nécessite que les acteurs apprennent à se connaître, échangent, travaillent. Non, pas pour, à la fin du compte, partir en vacances ensemble ou passer devant Monsieur le maire, mais pour dire au peuple français que « cette fois-ci, c’est la bonne»: c’est le redressement de la France qui nous intéresse, peut-être pas lui seul, mais, pour une fois, lui d’abord.
C’est notre conviction. C’est le sens de notre action. Autant de choses que nous voulons, également dans cette revue, faire partager au plus grand nombre.
Note: 1. Notons que le même article de la Constitution précise, dans la phrase suivante, que ces mêmes partis «doivent respecter les principes de la souveraineté nationale»… Ne soyons pas chafouins, tel n’est pas notre sujet aujourd’hui.