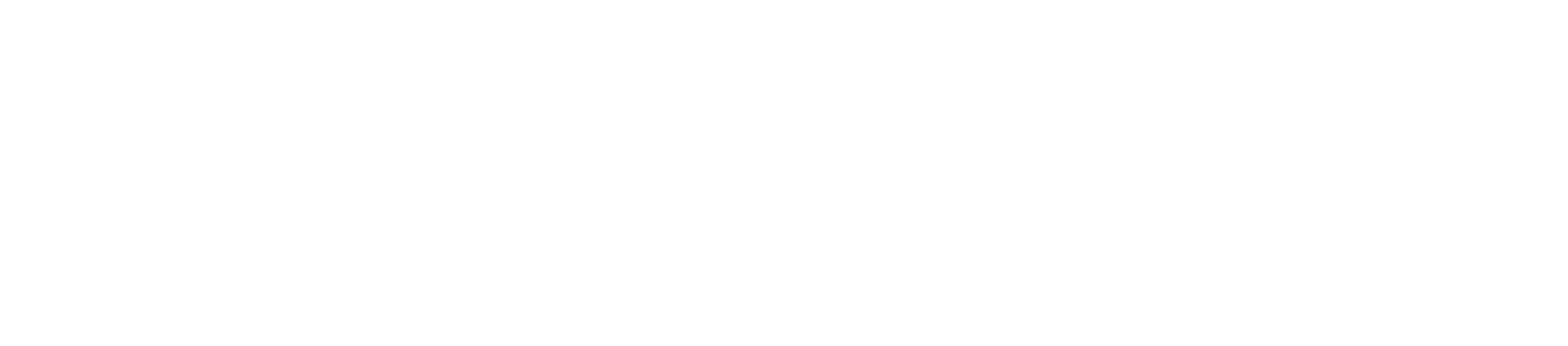Par Francis Jubert
Depuis quelques années, l’Europe affiche une volonté de se réarmer, portée par des discours ambitieux, notamment ceux du président français Emmanuel Macron et, plus récemment, des dirigeants britanniques. Cette dynamique, illustrée par des initiatives comme le plan « ReArm Europe » ou le Livre blanc sur la Défense, soulève une question fondamentale : comment concilier cette ambition collective avec la souveraineté nationale, domaine régalien par excellence, alors que « la Russie ne constitue pas une menace pour la France et pour l’Europe » (Pierre Lellouche, Lettre au président de la République au sujet d’une guerre qui pourrait dégénérer vers le pire)? L’étude de l’Institut Thomas More, intitulée Économie de guerre · Les défis derrière le slogan (17 avril 2025), offre un éclairage pertinent sur les contradictions et les enjeux de cette entreprise.
Une Europe en quête d’autonomie stratégique
Le concept d’« autonomie stratégique » européenne, martelé par Emmanuel Macron depuis son discours de la Sorbonne en 2017, est au cœur de cette volonté de réarmement. Dans son allocution du 5 mars 2025, il a appelé à un « réarmement massif » de l’Europe face à la menace russe et à l’incertitude des engagements américains sous la présidence Trump, évoquant même l’idée d’étendre la dissuasion nucléaire française à la protection du continent, une proposition audacieuse mais controversée. De son côté, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, dans un contexte post-Brexit, a insisté sur la nécessité pour l’Europe de réduire sa dépendance envers les États-Unis, tout en renforçant la coopération avec l’OTAN.
Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte géopolitique tendu : la guerre en Ukraine, les cyberattaques russes, et la fragilité des alliances transatlantiques sous la nouvelle administration Trump. L’Union européenne a répondu par des mesures concrètes, comme le déblocage de fonds pour armer l’Ukraine ou la proposition d’un budget de 800 milliards d’euros pour le plan « ReArm Europe ». Pourtant, l’Europe n’est pas directement en guerre, et la rhétorique belliciste de certains dirigeants européens contraste avec l’absence de menace imminente sur le sol européen.
Philippe de Villiers juge pour sa part « surréaliste » le discours d’Emmanuel Macron sur la menace russe qui relèverait du « fantasme » (JDNews , 12 mars 2025). Le président Macron serait prêt, selon lui, à succomber à « la tentation bismarckienne, qui consiste à utiliser la guerre pour faire une Europe supra-étatique« .
Plusieurs militaires français de haut rang expriment également leur scepticisme quant à la réalité d’une extension possible du conflit en Europe, soulignant que les risques restent, à ce jour, hypothétiques. Un conflit majeur en Europe est, pour l’heure, une hypothèse lointaine. L’évoquer est donc inutilement « anxiogène » (Pierre Lellouche)
La souveraineté nationale : un obstacle structurel
La défense, domaine régalien par excellence, reste jalousement gardée par les États membres. Comme le souligne l’étude de l’Institut Thomas More, les initiatives européennes en matière de défense se heurtent à des « divergences stratégiques» et à une « réticence à transférer des compétences souveraines ». Chaque pays a ses propres priorités : la Pologne et les États baltes privilégient une posture anti-russe, tandis que la France insiste sur une autonomie vis-à-vis des États-Unis. L’Allemagne, longtemps réticente à augmenter ses dépenses militaires, a opéré un virage stratégique en 2022, mais reste alignée sur l’OTAN.
Cette fragmentation est accentuée par des divergences industrielles et économiques. L’étude note que l’« économie de guerre » prônée par certains dirigeants européens implique une réindustrialisation et une coordination des chaînes d’approvisionnement, mais les intérêts nationaux prédominent. Par exemple, les contrats d’armement favorisent souvent les industries nationales, au détriment d’une approche européenne intégrée. La proposition de Macron d’un « budget de défense commun » ou d’une « force d’intervention commune » (Elysée, 2017) reste donc largement théorique, faute de consensus.
Une rhétorique belliciste hors contexte ?
Les déclarations d’Emmanuel Macron, qualifiées de « bellicistes » par certains, suscitent des interrogations. En 2018, il évoquait une « armée européenne », une idée reprise en 2025 avec l’urgence d’un réarmement face à la Russie. Pourtant, comme le souligne Le Monde diplomatique (avril 2025), l’Europe « assiste en spectatrice » aux négociations russo-ukrainiennes. Elle n’est pas davantage partie prenante de l’accord du 30 avril 2025 sur les terres rares signé entre l’Ukraine et les Etats-Unis qui prévoit la création d’un fonds d’investissement et de reconstruction, à participation égale entre les deux pays. Cette marginalisation fragilise la crédibilité des ambitions européennes. De plus, la Russie n’est pas l’Allemagne des années 1930, et la probabilité d’un conflit majeur en Europe reste hypothétique.
Le discours britannique, bien que moins flamboyant, reflète une préoccupation similaire. Le Premier ministre a appelé à une Europe « prête à se défendre », mais cette rhétorique s’adresse autant à l’opinion publique nationale qu’aux partenaires européens. L’étude de l’Institut Thomas More met en garde contre une « surenchère verbale » qui risque de masquer les véritables défis : coordination, financement, et acceptation politique d’une défense intégrée.
Une souveraineté européenne chimérique
Malgré quelques initiatives comme la Coopération structurée permanente (PESCO) ou le Fonds européen de défense, l’Europe reste fondamentalement dépendante de l’OTAN pour sa sécurité: l’OTAN est – et demeure – le pilier de la défense européenne. La dépendance vis-à-vis des États-Unis et l’absence de volonté réelle des États membres de céder leurs prérogatives souveraines rendent l’idée d’une « Europe puissance » aussi irréaliste qu’illusoire. Toute tentative de « souveraineté européenne » doit composer avec cette réalité.
Le refus des transferts de compétences régaliennes en matière de défense montre bien que l’idée d’une souveraineté européenne est largement perçue comme irréaliste. La fragmentation industrielle, l’incohérence des politiques d’armement et la méfiance généralisée entre États achèvent de réduire à néant ces ambitions collectives. La note de l’Institut Thomas More insiste sur ce point, relevant que les initiatives comme PESCO peinent à dépasser le stade symbolique en raison d’un manque criant de volonté politique.
La « souveraineté européenne » vantée par le président Macron ne serait dès lors qu’un concept vide, sans réel fondement juridique ni stratégique.
La souveraineté nationale, rempart incontournable
La défense, « première raison d’être de l’Etat » comme aimait à le rappeler le général de Gaulle, est le dernier bastion de la souveraineté nationale, jalousement préservé par les États membres. Loin d’être un projet consensuel, l’idée de souveraineté européenne reste avant tout le fantasme de quelques idéologues. En réalité, les pays de l’Union européenne demeurent farouchement attachés à leurs prérogatives régaliennes en matière de défense. La note de l’Institut Thomas More souligne avec justesse que ces divergences stratégiques et politiques annihilent les ambitions de réarmement collectif.
Les positions des États européens divergent selon leur géographie et leur histoire. Les pays situés à proximité de la Russie, comme les États baltes et la Pologne, privilégient une posture nettement anti-russe et soutiennent davantage les efforts de guerre. Ils voient dans l’OTAN, dominée par les États-Unis, la meilleure garantie de leur sécurité. À l’inverse, des pays comme l’Allemagne, plus éloignés de la menace immédiate, s’en remettent volontiers au parapluie américain tout en s’opposant à toute mutualisation des ressources militaires. Quant à la France, malgré ses discours flamboyants, elle peine à rallier les autres membres à une vision qu’elle prétend universelle mais qui reste strictement nationale.
Une rhétorique déconnectée
Pour autant, elle s’enlise dans un discours martial qui dissimule son incapacité à réformer profondément son appareil de défense. Thibault de Montbrial , président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, fait observer que l’armée française ne dispose pas des moyens de faire face à une menace ordonnée et qu’il y a urgence à restaurer une capacité de puissance (Les incertitudes de l’époque commandent un réarmement militaire, industriel, politique et moral, Le Figaro – champs libres- 11 mars 2025)
Pendant ce temps, le Royaume-Uni, débarrassé des illusions européennes après le Brexit, adopte une posture pragmatique en consolidant sa coopération avec l’OTAN.
Ce contraste éclaire la fragilité d’une vision française trop dépendante d’une rhétorique creuse. Les discours d’Emmanuel Macron peinent à masquer la vacuité de ses propositions. De l’« armée européenne » évoquée en 2018 au « réarmement massif » promis en 2025, cette rhétorique s’épuise face à une réalité implacable: l’Europe est écartée des grandes négociations stratégiques mondiales.
La note de l’Institut Thomas More éclaire également la déconnexion entre les ambitions affichées et la réalité industrielle européenne. Les projets d’armement commun, comme le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF), peinent à avancer en raison de rivalités nationales et de divergences industrielles. L’étude souligne que cette fragmentation, loin d’être résolue, freine toute tentative de coopération.
En conclusion, la volonté de réarmement européen est un projet ambitieux mais semé d’embûches : « Aujourd’hui, personne ne dira qu’il est contre la préférence européenne. Mais il y a peu, tout le monde y était opposé. Cette volonté est en train de se concrétiser. J’espère qu’elle s’installera sur le long terme. C’est du bon sens » fait remarquer Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation dans le JDD (23 mars 2025). La tension entre souveraineté nationale et ambitions collectives, exacerbée par une rhétorique parfois déconnectée du contexte, limite les avancées. Comme le note l’Institut Thomas More, le slogan d’« économie de guerre » doit s’accompagner d’une vision plus pragmatique, conciliant les intérêts divergents des États membres. Sans cela, l’Europe risque de rester une « puissance rhétorique », incapable de transformer ses ambitions en réalité stratégique.