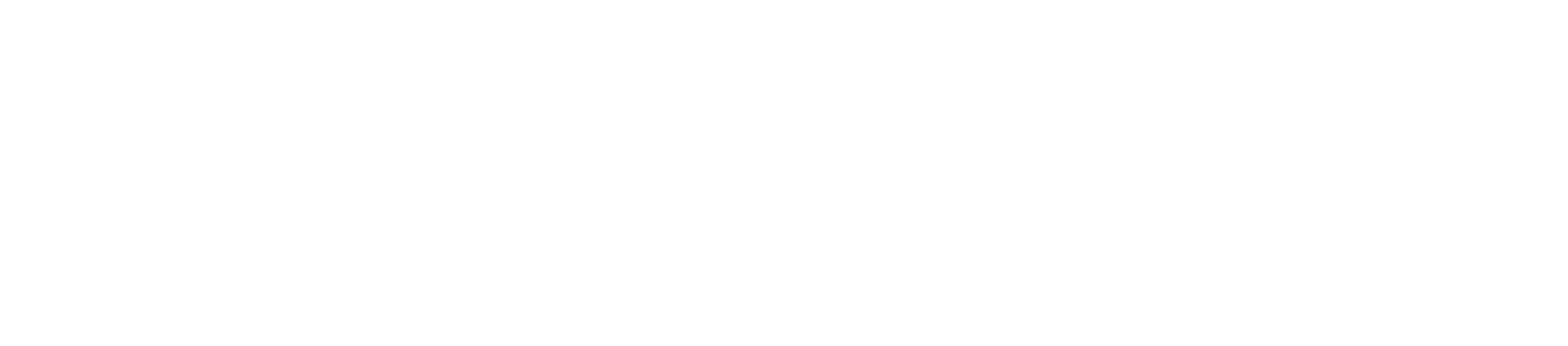Par Francis Jubert
Le 16 avril 2025, une tribune signée par 103 sénateurs français, a été publiée dans Le Figaro pour s’opposer à l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine en juin prochain, lors d’une conférence co-présidée avec l’Arabie saoudite. Cette initiative, selon les sénateurs, ignore la barbarie de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et les menaces du Hezbollah, deux groupes déterminés à rayer Israël de la carte.
La tribune des sénateurs : un appel à la raison face à une initiative hasardeuse
La tribune des sénateurs, portée par Roger Karoutchi, sénateur LR et figure respectée pour son engagement en faveur d’une diplomatie équilibrée, constitue une réponse ferme à l’annonce du président Macron le 8 avril 2025. Les signataires, issus de divers horizons politiques, dénoncent une décision unilatérale qui « trahirait la mémoire des victimes » du 7 octobre 2023. Ils soulignent que reconnaître un État palestinien dans ce contexte reviendrait à ignorer la menace existentielle posée par le Hamas, dont la charte appelle à la destruction d’Israël, et par le Hezbollah, qui bombarde le nord d’Israël depuis le Liban avec le soutien de l’Iran.
Les sénateurs rappellent que la France a elle-même reconnu que « les conditions ne sont pas réunies » pour une reconnaissance de l’Etat palestinien. L’Autorité palestinienne (AP), minée par la corruption et incapable de contrôler la bande de Gaza depuis 2007, n’offre pas selon le Quai d’Orsay les garanties nécessaires pour un État viable. De plus, le Hamas a salué l’initiative d’Emmanuel Macron comme une « victoire », un signal alarmant que les sénateurs jugent inacceptable. Pour eux, une reconnaissance unilatérale risquerait de légitimer indirectement le terrorisme, en envoyant un message de faiblesse face à des groupes qui rejettent toute coexistence avec Israël. Ils plaident pour une solution négociée, respectant la sécurité d’Israël et les aspirations palestiniennes, plutôt qu’un geste symbolique déconnecté selon des réalités.
Les acteurs du jeu diplomatique : un équilibre précaire
Le projet d’Emmanuel Macron s’inscrit dans un contexte diplomatique complexe, impliquant plusieurs acteurs aux agendas divergents. Le président français, en quête d’un rôle de médiateur international, mise sur une conférence en juin 2025, co-présidée avec Mohammed Ben Salman (MBS), le prince héritier saoudien. MBS, qui cherche à renforcer l’influence de Riyad, soutient publiquement la cause palestinienne, mais maintient des canaux discrets avec Israël pour contrer l’Iran.
Côté palestinien, l’Autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, est affaiblie par son manque de légitimité et son incapacité à unifier les factions en présence. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, reste inflexible, rejetant les propositions de cessez-le-feu et utilisant les otages comme levier. Le Hezbollah, quant à lui, intensifie ses attaques depuis le Liban, alimentant l’instabilité régionale. Ces groupes, soutenus par l’Iran, représentent une menace directe pour Israël qui, sous la direction de Benyamin Netanyahou, rejette catégoriquement la reconnaissance unilatérale, la qualifiant de « récompense pour le terrorisme ».
Les États-Unis, traditionnellement alignés sur Israël, adoptent une position prudente, privilégiant les négociations bilatérales et les accords d’Abraham qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. L’Égypte et la Jordanie, partenaires historiques de la paix, soutiennent quant à eux la solution à deux États, mais insistent sur des garanties sécuritaires.
Dans ce paysage, la tribune sénatoriale met en garde contre une initiative française qui, en marginalisant les négociations directes, risque de perturber ces dynamiques régionales. Roger Karoutchi et ses collègues insistent sur la nécessité de pouvoir s’appuyer sur un partenaire palestinien crédible, capable de rejeter le terrorisme, avant d’envisager une reconnaissance.
Les dangers d’une reconnaissance unilatérale
La tribune des sénateurs énumère plusieurs risques liés à la reconnaissance unilatérale. Envisagée par Emmanuel Macron. Premièrement, elle affaiblirait Israël, qui reste malgré tout confronté à des menaces véritablement existentielles. Les sénateurs rappellent que le Hamas et le Hezbollah, loin de chercher la paix, poursuivent une logique de guerre totale. Une reconnaissance de l’Etat palestinien dans ce contexte pourrait enhardir ces groupes, qui y verraient une validation de leurs stratégies violentes. Le Hamas, par exemple, continue à utiliser les souffrances des civils gazaouis pour sa propagande, tout en rejetant les efforts de médiation.
Deuxièmement, elle compromettrait les efforts diplomatiques régionaux. Les accords d’Abraham ont démontré que la normalisation entre Israël et les États arabes peut progresser sans gestes unilatéraux. Une reconnaissance précipitée comme celle envisagée par Emmanuel Macron risquerait de polariser les positions, en éloignant des partenaires comme l’Arabie saoudite, qui, malgré le discours de MBS, n’a pas rompu ses discussions avec Israël. Les sénateurs soulignent que contourner les négociations bilatérales décrédibiliserait la solution à deux États, un objectif que la France défend depuis des décennies.
Troisièmement, elle pourrait exacerber les tensions en France même. Le conflit israélo-palestinien, déjà source de divisions nombreuses, a suscité de nombreuses controverses, comme l’incident du drapeau palestinien brandi à l’Assemblée nationale en 2024. Une reconnaissance perçue comme unilatérale risquerait d’alimenter les extrémismes, au détriment de la cohésion nationale. Roger Karoutchi, dans ses interventions au Sénat, a souvent appelé à une diplomatie qui ne sacrifie pas les principes républicains sur l’autel des relations internationales.
Les conditions d’une reconnaissance raisonnable
Pour les sénateurs, une reconnaissance de la Palestine ne peut être envisagée sans conditions claires. Premièrement, le Hamas et le Hezbollah doivent renoncer à leur objectif de détruire Israël. Cela passe par une réforme de leurs chartes respectives et un cessez-le-feu durable. Sans cela, un État palestinien risquerait de devenir une plateforme pour de nouvelles attaques, sur le territoire israélien comme l’a été Gaza sous le Hamas. Deuxièmement, l’Autorité palestinienne doit se réformer, via des élections transparentes et une lutte contre la corruption, pour devenir un partenaire fiable. Enfin, la reconnaissance doit s’inscrire dans un cadre négocié, garantissant tout à la fois la sécurité d’Israël et la viabilité de l’État palestinien.
Roger Karoutchi insiste tout particulièrement sur ce point : la paix exige des partenaires qu’ils s’engagent résolument dans le dialogue, non dans la violence. Les exemples de l’Espagne, de l’Irlande et de la Norvège, qui ont reconnu la Palestine en 2024, montrent que ces gestes symboliques n’ont eu aucun impact concret, si ce n’est de tendre les relations avec Israël. Une reconnaissance unilatérale, loin de rapprocher les parties, risquerait de les éloigner davantage.
Une diplomatie française au service de la paix
Plutôt qu’une reconnaissance unilatérale, la France doit jouer un rôle de médiateur impartial, comme le préconisent les sénateurs. Cela implique de condamner fermement le terrorisme du Hamas et du Hezbollah, tout en soutenant les aspirations palestiniennes, en mettant par exemple en place une aide humanitaire ciblée et des réformes de l’Autorité Palestinienne. La France doit également maintenir son soutien à la sécurité d’Israël, via la coopération militaire et une position ferme contre l’Iran. Enfin, elle devrait encourager des négociations multilatérales, incluant l’Égypte, la Jordanie et les États-Unis, plutôt que de s’appuyer sur des initiatives symboliques.
Conclusion
La tribune des sénateurs, portée par Roger Karoutchi, est un rappel salutaire : reconnaître l’État de Palestine aujourd’hui, alors que le Hamas et le Hezbollah prônent la destruction d’Israël, loin de favoriser la paix, risquerait de légitimer le terrorisme et d’affaiblir les négociations. Les sénateurs appellent à une diplomatie équilibrée, respectant la sécurité d’Israël et les aspirations palestiniennes. La France devrait s’appliquer à privilégier des négociations bilatérales et des réformes palestiniennes, plutôt que de se préparer à poser un geste unilatéral déconnecté des réalités. C’est à ce prix qu’une paix durable pourra in fine émerger.
Nota Bene: François Martin et le conflit israélo-palestinien
François Martin, qui publie régulièrement des articles dans Le Nouveau Conservateur, défend pour sa part une position pro-palestinienne marquée, dénonçant l’attitude belliqueuse du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
Selon lui, Benjamin Netanyahu mène une politique inutilement agressive, marginalisant les Palestiniens et ignorant leurs droits fondamentaux. François Martin critique l’occupation des territoires palestiniens, les colonies illégales et les opérations militaires en cours, qu’il juge disproportionnées, notamment dans la bande de Gaza.
Il accuse le dirigeant israélien de privilégier la sécurité d’Israël au détriment de la justice pour les Palestiniens, ce qui à ses yeux est une caractéristique de la doctrine sioniste qui prône un état d’Israël sur tout le Moyen-Orient et la poursuite de la colonisation des terres palestinienne qui n’a jamais cessé depuis 1948, le tracé des frontières d’Israël n’ayant jamais été déposé.
Pour François Martin, la solution passe par la reconnaissance d’un État palestinien souverain, basé sur les frontières de 1967, et une pression internationale accrue sur Israël pour cesser les hostilités et faire respecter le droit international. Il insiste sur l’urgence d’une paix équitable, dénonçant l’inaction globale face à la souffrance palestinienne.