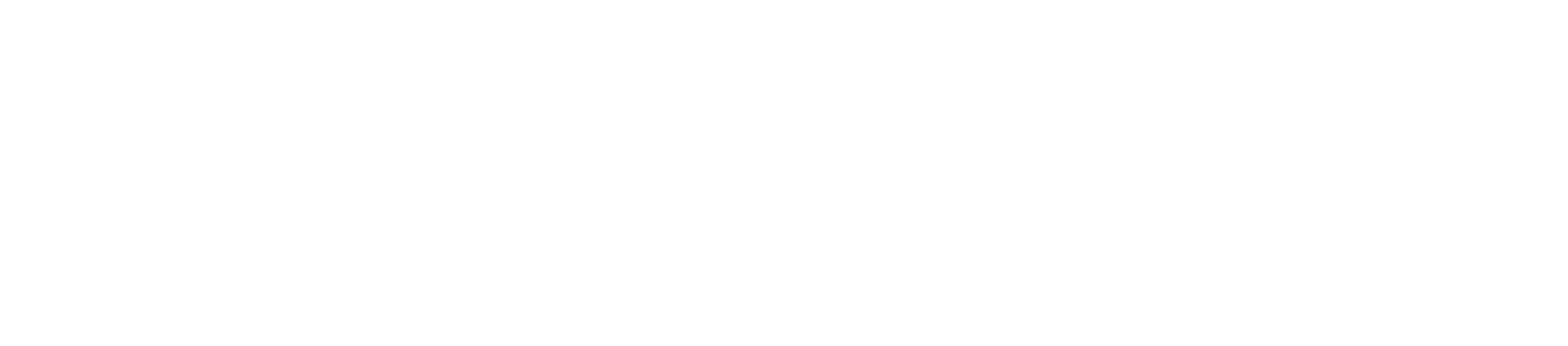Par Francis Jubert
Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Marine Le Pen à une peine
d’inéligibilité, assortie de l’exécution provisoire. Cette décision exclut de fait l’une des
principales figures de la vie politique française de la prochaine élection présidentielle, alors
même que son appel n’a pas encore été entendu. Ce n’est pas seulement une candidate qui est
frappée, c’est un courant politique entier qui est neutralisé — et à travers lui, plusieurs
millions d’électeurs, privés de leur droit élémentaire à choisir leur représentant.
Le verdict ne constitue pas seulement une décision judiciaire : il s’apparente à un acte
politique, juridiquement contestable, mais redoutablement efficace dans ses effets. La
démocratie française entre ici dans une zone grise, où le suffrage universel devient
conditionnel, et la justice, un outil de régulation du jeu politique.
Une peine d’inéligibilité sans appel : le contournement du suffrage
Marine Le Pen est condamnée dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires
européens, affaire déjà ancienne, aux contours juridiques flous. Pourtant, le tribunal décide de
prononcer une peine lourde, et surtout, de l’appliquer immédiatement, avant même que la
procédure d’appel ne soit close. Le message est clair, et d’ailleurs les juges ne s’en cachent
pas, il s’agit d’empêcher la candidate d’être présente au rendez-vous électoral de 2027.
Cette précipitation soulève des interrogations majeures. Le professeur Christophe Boutin le
rappelait récemment dans Politeia : « La justice pénale, dans un État de droit, doit être
impartiale et proportionnée. Quand elle s’aligne sur un calendrier politique, elle devient
suspecte. » Or, ici, la concordance des temps interroge : à deux ans de la présidentielle, une
candidate capable de rassembler près de 40 % des suffrages est exclue sur décision judiciaire,
sans qu’un second juge n’ait encore statué.
Le droit au double degré de juridiction, garanti par la Convention européenne des droits de
l’homme, se trouve vidé de sa substance. Une peine peut-elle produire ses effets les plus
destructeurs avant même d’être confirmée ? L’urgence invoquée par les juges n’a rien
d’évident, si ce n’est l’urgence d’écarter une figure politique dérangeante.
Un procès faiblement argumenté : les juges en terrain glissant
Au-delà de l’effet, c’est le fond de l’affaire qui interroge. Le dossier repose sur un litige bien
connu : les modalités de recrutement des assistants parlementaires européens, une question
administrative devenue affaire pénale. Or, comme le souligne Catherine Rouvier, docteur
d’Etat en droit public, qui vient de publier La France Colin-Maillard (Presses de la
Délivrance, 2025), interrogée sur Radio Courtoisie : « Ce procès souffre d’un flou juridique
originel. Ni les règlements du Parlement européen ni les directives françaises ne définissent
précisément les limites entre activités locales et européennes. »
Autrement dit, l’infraction est loin d’être évidente. Il ne s’agit pas d’un détournement de
fonds avéré, mais d’une interprétation extensive des fonctions des assistants. Dans ce contexte
incertain, le tribunal aurait pu faire preuve de prudence. Il a préféré faire un exemple. Auteur d’un livre d’une brûlante actualité sur Le Gouvernement des juges – Histoire d’un
mythe politique (Desclée de Brouwer, 2023), Frédéric Rouvillois, insiste dans une tribune
récente : « Nous assistons à une nouvelle forme de censure politique : la disqualification
juridique. Moins visible qu’une interdiction administrative, mais tout aussi efficace pour
neutraliser un adversaire. » Le rôle du juge n’est plus de dire le droit, mais de trier les
candidatures recevables au nom d’un ordre politique implicite.
Une justice à géométrie variable : François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon
dans l’ombre du précédent
L’asymétrie devient manifeste lorsque l’on compare ce traitement à celui d’autres figures
politiques. François Bayrou, président du MoDem, a lui aussi été condamné à une peine
d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires de son parti. Mais son exécution
n’est pas immédiate, et son procès en appel n’aura lieu qu’après celui de Marine Le Pen, prévu
à l’été 2026. Il reste donc éligible – et influent comme Premier ministre – jusqu’à nouvel
ordre. Quant à Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, il est lui aussi visé par
plusieurs procédures judiciaires, notamment pour sa réaction aux perquisitions de 2018. Lui-
même a reconnu sur France 2 en mars dernier : « Il y a désormais un vrai risque que les juges
écartent un à un les candidats qui dérangent. » Preuve que l’inquiétude dépasse les clivages
politiques. Le système judiciaire semble ainsi fonctionner à deux vitesses. Les opposants sont frappés en priorité, selon un calendrier opportun, tandis que les alliés du pouvoir bénéficient de délais, de nuances, de clémences procédurales. Deux poids, deux mesures ? La perception en tout cas est installée. Et elle mine la confiance des citoyens dans les institutions.
Quand le juge remplace l’électeur : une démocratie faussée
Dans une démocratie digne de ce nom, c’est le peuple qui tranche, pas un juge unique en
première instance. Or, c’est exactement ce que cette décision vient renverser. Marine Le Pen
ne pourra pas être candidate, non parce qu’elle aura été battue dans les urnes, mais parce
qu’un tribunal, sans appel entendu, l’en aura empêchée. Ce n’est pas une exception : c’est un
précédent.
Sur CNews, Philippe de Villiers a résumé la situation d’une formule choc : « On entre dans la
démocratie sous contrôle judiciaire. C’est une société où l’on choisit pour vous qui vous avez
le droit d’élire. » Derrière la formule, une réalité : le suffrage devient conditionnel. L’offre
politique est préalablement filtrée, nettoyée, censurée.
Dans cette logique, chaque future élection pourrait être affectée par des décisions judiciaires
opportunes, frappant tel ou tel candidat au moment décisif. Le juge ne dit plus seulement le
droit : il devient arbitre du débat politique, organisateur du casting présidentiel.
Un basculement silencieux : vers un gouvernement des juges ?
Ce que révèle l’affaire Marine Le Pen, ce n’est pas seulement un jugement sévère. C’est un
changement de régime implicite, un véritable basculement institutionnel, une nouvelle pratique du pouvoir. Quand les magistrats interviennent dans le champ politique avant les électeurs, la séparation des pouvoirs est compromise, et l’État de droit vacille.
Cette dérive est d’autant plus dangereuse qu’elle est peu contestée. Selon le dernier baromètre
Verian, seuls 21 % des Français font confiance à l’actuel président, contre 57 % en 2017. Mais
65 % ne se disent pas choqués par la décision de justice contre Le Pen. Par lassitude, par peur
d’être accusés de connivence avec le RN, ou simplement par résignation.
Or, ce qui est en cause ne concerne pas le RN seul. Demain, d’autre juges pourront s’en
prendre au MoDem, à LFI, ou à n’importe quelle autre formation politique. La mécanique est
là. Elle peut s’appliquer à tous.
Sortir de l’impasse : vers une réponse institutionnelle
Il existe des réponses. Une réforme législative pourrait être proposée pour suspendre
l’exécution immédiate des peines d’inéligibilité, sauf en cas de crime avéré ou de danger
manifeste pour l’ordre public. Un recours administratif contre l’exécution provisoire peut
également être envisagé.
Mais surtout, il faut une prise de conscience civique. Le respect du pluralisme politique, du
droit de vote, de la présomption d’innocence et du principe d’égalité devant la loi n’est pas
une affaire de droite ou de gauche. C’est un socle démocratique commun.
Conclusion : défendre la démocratie, ce n’est pas défendre un parti – c’est
défendre le peuple
Marine Le Pen n’est pas au centre de cette affaire en tant qu’individu, mais comme symbole
d’un possible choix électoral qu’un tribunal a voulu interdire. Cette disqualification anticipée
d’un candidat crédible constitue une atteinte directe à la souveraineté populaire.
Que l’on soutienne ou non le RN, une telle décision devrait alarmer tous les citoyens. Car ce
qui s’est joué ici, c’est la possibilité pour le peuple français de choisir librement ses
dirigeants. Si cette possibilité est désormais soumise au bon vouloir des magistrats, alors nous
avons quitté le terrain de la démocratie pour entrer dans celui du gouvernement des juges.
Il est temps de réagir. Non par esprit de revanche ou de parti, mais pour préserver ce qui reste
du contrat démocratique. Car à ce rythme, c’est tout l’équilibre des institutions qui pourrait
basculer – dans le silence d’une opinion anesthésiée et la complicité passive des élites.