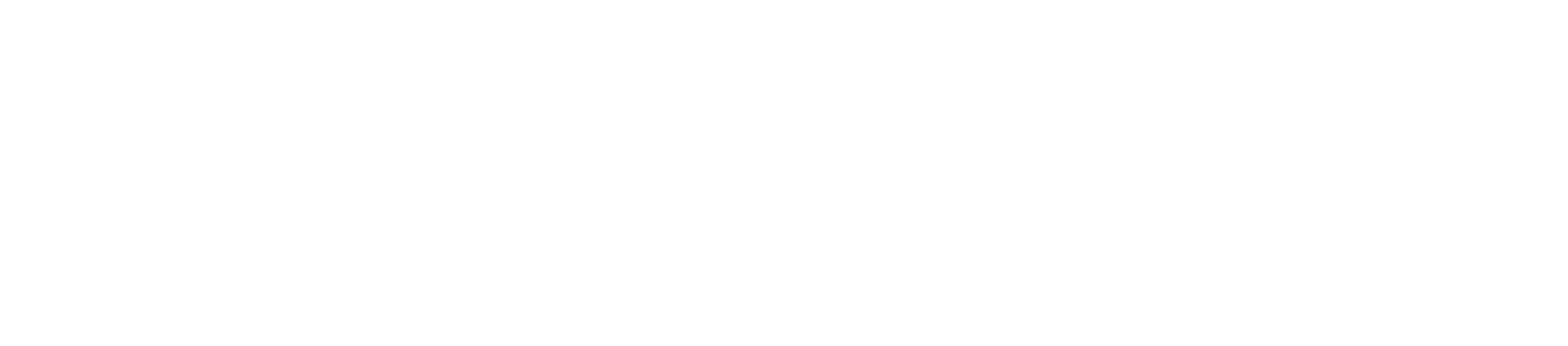Entretien avec Laurent Duplomb.
Laurent Duplomb est agriculteur, installé en Haute-Loire. Membre de la FNSEA, il a été président de la chambre d’agriculture de Haute-Loire. Élu au Conseil Municipal de Saint-Paulien en 2008, il a été élu maire en 2010 et réélu en 2014. Il est sénateur LR de Haute-Loire depuis 2017. En septembre 2022, il a été le coordinateur d’un rapport sénatorial dénonçant l’état de l’agriculture française et appelant à redresser sa compétitivité pour améliorer la souveraineté alimentaire de la France. Il est l’auteur, avec son confrère Franck Menonville, sénateur de la Meuse, de la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 27 janvier 2025. Il a bien voulu répondre à nos questions.
Monsieur le Sénateur, vous êtes co-auteur d’une proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Pouvez-vous, pour nos lecteurs qui ne sont pas tous familiers des questions liées à l’agriculture, nous dire sommairement en quoi consistent ces contraintes ?
Ces contraintes proviennent majoritairement de surtransposition des règles européennes.
La France, année après année, a voté à l’intérieur de ses lois ou dans ses règlements des normes supplémentaires aux règles que l’Europe impose à tous les États membres. Cela augmente les contraintes pour les producteurs français comparativement à leurs concurrents allemands, espagnols ou italiens ou autres. Et cela les met dans une concurrence déloyale, parce que, soit ils passent plus de temps à répondre à ces contraintes, soit cela leur coûte plus cher en termes d’investissement, soit, au pis, cela arrive même à les mettre dans l’incapacité de produire, par exemple, quand cette surtransposition conduit à l’interdiction de certaines molécules de produits phytosanitaires qui sont utilisées par nos concurrents, mais interdites en France.
Au nombre de plus de 2,5 millions en 1955, les exploitants agricoles en France étaient en 2020, selon le recensement agricole, 496 000. Corollaire de cette évolution, le nombre d’exploitations diminue, avoisinant 389 000 en France métropolitaine, près de 800 000 de moins qu’en 1980. Les exploitants étaient âgés en moyenne de 51,4 ans en 2020, contre 52,2 en 2010. La part des agriculteurs de 60 ans ou plus augmente. La question de la transmission des exploitations va devenir cruciale. Que peut faire le législateur pour faciliter ces transmissions ?
Le projet de loi d’orientation agricole que nous venons d’adopter au Sénat apporte quelques réponses à cette question. Elle permet de mettre en relation des cédants avec de jeunes agriculteurs, soit issus du milieu agricole, soit avec des jeunes, ou moins jeunes, non issus du monde agricole, mais intéressés par un tel projet.
Le législateur peut donc agir, à travers les articles de lois que nous avons votés dans le projet de loi d’orientation agricole, pour améliorer la discussion avec un guichet unique, avec la possibilité d’aider au diagnostic de l’exploitation à reprendre et d’avoir un conseil stratégique qui permette de voir comment pourra évoluer cette exploitation d’un point de vue technico-économique, mais aussi par rapport au changement climatique, avec un test grandeur nature pour savoir si l’exploitation pourra résister à l’évolution du climat. Ce sont ces éléments qui peuvent permettre d’aider les jeunes à s’installer.
Il y a aussi la politique de soutien à l’installation, c’est-à-dire la dotation aux jeunes agriculteurs, qui permet d’avoir une aide financière à l’installation. Mais je pense que la tâche la plus importante pour favoriser l’installation serait d’arrêter de parler de l’agriculture de façon négative. Il y a aujourd’hui des associations et des partis politiques qui sont toujours dans l’invective, en disant qu’il faut changer de modèle, que les agriculteurs ne savent pas s’adapter… C’est avant tout le regard porté par certains de nos concitoyens qu’il faut changer !
Nous avons, en France, des charges beaucoup plus élevées que nos concurrents.
La France détient la plus grande surface agricole d’Europe, 28 millions d’hectares. Ses rendements sont parmi les plus hauts, comparativement à nos voisins. Toutefois, nous sommes loin d’être autonomes. Grandement exportateur, mais aussi fortement importateur, le pays ne fournit aujourd’hui que 60 % des aliments nécessaires pour satisfaire la consommation de ses habitants. Que faire pour recouvrer notre souveraineté alimentaire ?
Cela passe par plusieurs éléments. Le plus important – et c’est le sens du rapport que j’ai écrit en 2018, et de la proposition de loi qui en a suivi – est d’améliorer la compétitivité de la ferme-France en combattant quatre obstacles, qui sont la cause de notre affaissement agricole.
Tout d’abord, nous avons des charges en France beaucoup trop élevées, bien plus élevées que nos concurrents, qu’ils soient européens ou hors d’Europe. Le coût du travail est très cher en France, il ne favorise pas la compétitivité. Les normes et la surtransposition aggravent cette situation. Le seul avantage concurrentiel que nous avons encore avec les autres pays, c’est le coût du foncier et le coût du fermage concernant ce foncier.
La deuxième difficulté, c’est une guerre des prix, qui (un peu moins maintenant avec la loi Egalim) fait que la grande distribution met une telle pression sur l’agroalimentaire que ce secteur ne génère pas les bénéfices suffisants pour pouvoir faire les investissements nécessaires pour rester dans la course de la compétitivité.
La troisième difficulté, qui explique notre manque de compétitivité et donc l’abaissement de notre souveraineté, c’est un État qui n’est pas suffisamment protecteur. Quand vous imposez sans cesse des surtranspositions et des contraintes supplémentaires et que, dans le même temps, vous signez des contrats de libre-échange sans contrôler les produits qui rentrent sur le territoire national, vous créez d’office une concurrence déloyale au détriment de l’agriculture française.
Enfin, la dernière difficulté, ce sont les messages sans cesse à charge contre l’agriculture française, comme ceux qui, par exemple, sont diffusés par l’association L214 qui dit que les élevages français sont industriels, alors que la moyenne par exploitation est de soixante vaches, alors que, lorsque l’on signe des traités de libre-échange comme le Mercosur ou le CETA, vous vous retrouvez en concurrence avec des exploitations qui font de l’engraissement dans des élevages de 10 000, voire 30 000, bêtes.
Il faut tout faire pour garder le modèle agricole familial, parce que c’est un modèle vertueux et respectueux de l’environnement.
Le modèle agricole familial dans lequel capital et travail sont fortement imbriqués a longtemps été le modèle majoritaire, voire exclusif en France. Est-il encore pertinent ? Si oui, que faire pour le sauvegarder ? Sinon, quelle alternative ?
Je suis agriculteur dans un modèle agricole familial. Je travaille avec mon épouse, mon fils et mon neveu qui, bien que n’étant pas lui-même fils d’agriculteur, vient de nous rejoindre en ce début d’année. Oui, il faut tout faire pour garder ce modèle agricole familial, parce que c’est un modèle vertueux, qui nous permet d’avoir l’agriculture la plus respectueuse de l’environnement au monde. Et pourtant, le message qu’on véhicule est tout l’inverse. Cela ne veut pas dire que les Français n’attachent pas beaucoup d’importance à leur agriculture, bien au contraire. Le nombre important de visiteurs chaque année au Salon de l’Agriculture est là pour le prouver. Mais c’est un peu l’amour vache, c’est-à-dire que, d’un côté, ils répondent à 85 % être amoureux de l’agriculture ; et pourtant ils véhiculent toujours le message que l’agriculture est industrielle, qu’elle pollue, que les produits sont moins bons…
À nous donc de changer le regard des Français sur notre agriculture.
Enfin, que pouvez-vous nous dire du projet de traité de libre-échange avec les pays du Mercosur ?
La difficulté des contrats de libre-échange que nous signons est que nous ne contrôlons jamais le respect des clauses que nous avons mises dans ces contrats. Prenons l’exemple du traité CETA, qui continue d’évoluer alors que le Sénat a voté contre cet accord de libre-échange. La direction F de la Commission européenne qui est chargée de faire les contrôles dans les pays avec lesquels on a signé des contrats de libre-échange a fait deux rapports en 2019 et 2022 signalant publiquement qu’il y avait des anomalies majeures dans le respect des conditions que l’Europe avait imposées dans cet accord (traçabilité des animaux, utilisation massive d’antibiotiques activateurs de croissance). S’il y avait eu, dans une exploitation française, de tels constats, le soir même, nous aurions eu l’interdiction d’exporter. Et pourtant, le Canada a toujours l’autorisation d’exporter ! Cela va parfois même plus loin. L’Europe fait parfois baisser des normes pour favoriser l’importation, je pense par exemple au taux de glyphosate autorisé dans les lentilles canadiennes, alors que le taux de glyphosate sur les lentilles cultivées en France doit être nul (Ndlr : le glyphosate est utilisé pour arrêter le cycle végétatif de la plante afin de favoriser sa maturation). On ne peut pas signer un contrat de libre-échange avec un pays si on n’a pas les mêmes règles de fonctionnement et les mêmes coûts de production !