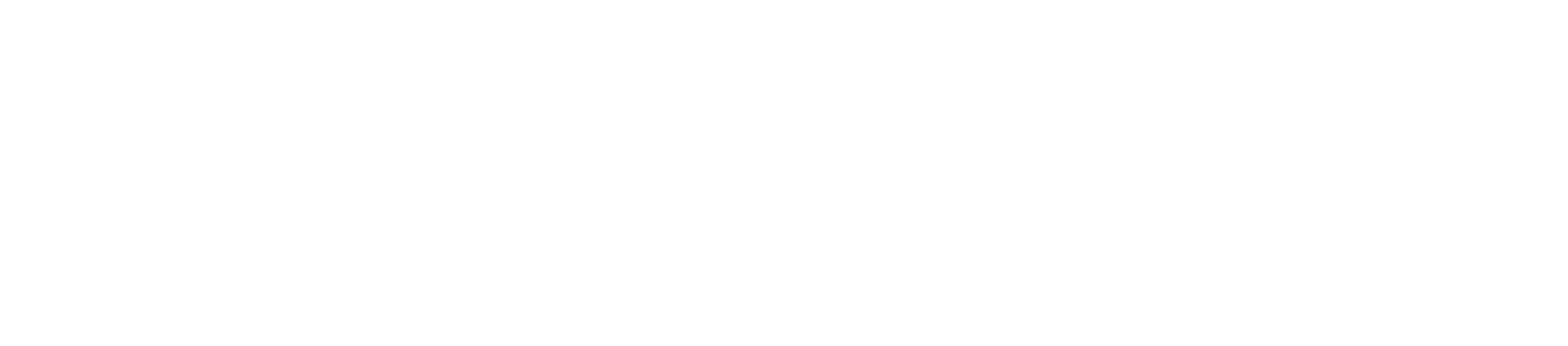Entretien avec Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice. Propos recueillis par Paul-Marie Coûteaux

Il est des signes que ne trompent pas : femme solide et décidée, Christine Bonfanti-Dossat entend se faire appeler, non pas « sénatrice », mais « Sénateur du Lot-et-Garonne », jugeant avec pertinence que le titre l’emporte que la personne. Gaulliste de bonne souche, élue en 1998 Conseil régional d’Aquitaine puis, en 2015, Conseiller départemental du canton « Agen Sud-Est » enfin, en 2017, Sénateur du Lot-et-Garonne, elle compte parmi ces élus LR qui n’ont pas leur langue dans leur poche. Après un rapport remarqué sur les soins palliatifs écrit avec Mme Corinne Lambert, le Sénat lui confie la délicate mission de rapporteur de la future loi sur l’euthanasie, tout en connaissant son opposition à l’inspiration générale du texte gouvernemental. Nous la remercions vivement d’avoir accepté de répondre en exclusivité aux questions du Nouveau Conservateur. En contrepoint, nous publions, avec l’accord du Figaro, un texte que l’écrivain Michel Houellebecq avait publié dans ses colonnes à l’occasion de la terrible « affaire Lambert » qui avait abouti à la décision de ne plus alimenter ni abreuver ce grand accidenté de la route – qui, pourtant, à 42 ans, n’était pas nécessairement « en fin de vie ». Faut-il rappeler que Vincent Lambert n’est mort ni de maladie, ni de vieillesse mais de faim et de soif – dans un hôpital, le CHU de Reims, de sinistre mémoire…
Jugez-vous que nos contemporains comprennent la question de l’euthanasie dans toute sa dimension ? N’est-elle pas à situer dans le nouveau rapport à la Vie qu’instaure par petites touches une forme un peu étourdie de la modernité : la Vie humaine est de moins en moins sacrée, comme le montrent les manipulations génétiques, la progression de l’eugénisme ou l’augmentation régulière des durées légales d’avortement ?
Notre monde traverse une période de désorientation profonde. Les paradigmes ont totalement changé. Nous sommes en train, sans nous en rendre compte, de tout changer, jusqu’à nos façons de penser – et, même, de changer nos valeurs.
Nous passons subrepticement à un nouveau monde, beaucoup plus brutal, où règne en maître un vaste système d’inversion de nos valeurs. C’est ainsi qu’une grande majorité des Français semble considérer le droit à l’euthanasie comme une évidence, qui modifie en profondeur notre approche et nos convictions les mieux ancrées, en profondeur, alors qu’elle contredit l’un de nos principes de base, la protection de la vie.
En se rendant maître de la nature, l’homme veut se rendre maître de la mort. Après l’abolition de la peine de mort, nous allons vers l’abolition de ce qu’on appellera bientôt un jour « la peine de vie ». C’est insensé ! « Le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain », disait pourtant Robert Badinter… Je crains que tout cela ne nous fasse franchir un saut anthropologique fort dangereux.
Il est facile d’affirmer, lorsqu’on est bien portant, qu’on est favorable à l’euthanasie…
« Dangereuse », c’est justement comme cela que, co-auteur du rapport parlementaire sur le sujet, vous jugez l’introduction de l’euthanasie dans notre législation. Comment comprenez-vous que le débat parlementaire ait été précédé d’une Convention citoyenne qui semble l’avoir préempté : à l’heure où le gouvernement annonce derechef un projet de loi, pensez-vous que, par le Parlement, il soit encore possible de lancer le débat national que cette question mérite ?
La « Convention citoyenne » est, pour moi, un leurre. Sous prétexte d’un constat (on meurt mal en France) et d’un principe (il est interdit de souffrir), une grande majorité de ses participants a été favorable à la loi sur la fin de vie et se prononce en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté. Je demeure sceptique sur la forme. Je n’irai pas jusqu’à dire que les réponses aux questions posées étaient très orientées en faveur de l’euthanasie mais on peut se poser la question : les participants connaissaient-ils le sujet dans toutes ses dimensions ?
Il est facile d’affirmer, lorsqu’on est bien portant, qu’on est favorable à l’euthanasie. Je suis favorable à un débat national mais, avant de le mettre en place, nous avons l’obligation d’être pédagogues. Le grand public a une méconnaissance totale de ce qui existe : qui a rédigé ses directives anticipées ? Qui a choisi sa « personne de confiance » ? Qui connaît la loi Claeys-Leonetti ? Qui connaît vraiment les soins palliatifs ? Je pose ces questions en préalable à tout débat.
À mon avis, il est urgent de passer du réflexe pavlovien à une authentique et profonde réflexion collective et de poser les bonnes questions ; mais cela ne peut se faire qu’en connaissance de cause.
Avec cette loi, nous risquons de sortir de la civilisation…
Pensez-vous que, si les Français connaissaient mieux cette manière si opportune d’accompagner les mourants que sont les soins palliatifs, la question de l’euthanasie se poserait en termes plus sereins, voire ne se poserait plus du tout ?
Sur les 80 % des personnes interrogées qui se déclarent en faveur de l’euthanasie, seules 2 % la réclament au bout du bout. Ce qui veut bien dire que, dès l’instant où la souffrance est maîtrisée, la vie s’acharne à vivre. Il est bouleversant de voir comme les êtres humains tiennent à vivre – à vivre autrement certes, mais à vivre. Le médecin philosophe Georges Canguilhem nous dit : « Ils inventent une autre allure de vie. »
L’euthanasie ne peut donc pas être l’unique solution au « mal mourir », dès lors que les lois qui régissent la fin de vie ne sont pas suffisamment mises en oeuvre et encore trop mal connues du grand public.
Dans un article publié récemment dans nos colonnes, l’abbé de Tanoüarn estimait que l’interdiction de l’euthanasie « ressort de l’évidence puisqu’il s’agit d’une de ces évidences indémontrables qui ont construit les civilisations humaines et qu’on ne saurait remettre en cause publiquement sans faire courir de graves dangers à chacun de nos concitoyens ». Si vous n’aviez qu’un argument à opposer à ce droit de donner la mort, serait-ce celui-ci ? Quel autre argument mettriez-vous en avant ?
Comme le dit Jean Léonetti : « Dans cette loi, on voit bien qu’il ne s’agit pas d’aller plus loin, mais d’aller ailleurs. » C’est de cet « ailleurs », cet « hors de la civilisation » que parle Guillaume de Tanoüarn, et cet argument est évidemment très fort.
Il y a beaucoup d’arguments, en réalité ! Par exemple celui-ci : donner la mort n’est pas un soin et ne sera jamais un soin ! La main qui soigne ne peut être la main qui tue.
Ce texte ne conduirait pas notre pays vers plus de vie, mais vers la mort comme solution à la vie. « On ferme les yeux des morts avec douceur, c’est aussi avec douceur qu’il faut ouvrir les yeux des vivants », disait Jean Cocteau. Je suis prête à relever le défi !