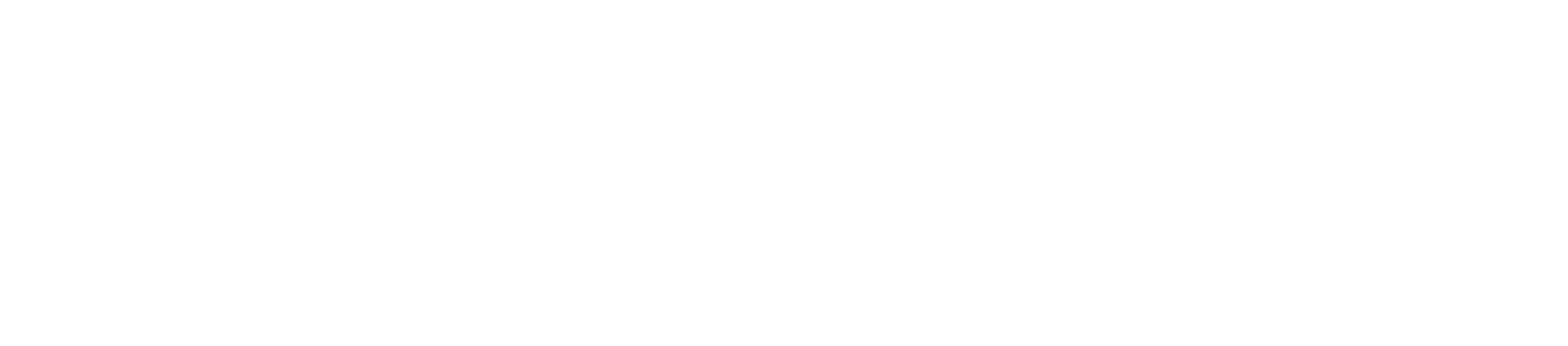Par Paul-Marie Coûteaux et Guillaume de Thieulloy
Nous avons « un grave problème », comme on dit aujourd’hui, avec les mots, surtout avec ceux du vocabulaire politique, si formatés, si satinés d’idéologie, qu’ils finissent par mentir et que, par le fait, la réalité nous échappe.
En particulier, l’actuel débat au Parlement sur l’euthanasie et le suicide assisté nous offre une parfaite illustration de l’allergie profonde que semble éprouver la gauche pour la réalité. Frappante, l’hystérie de nombreux députés de gauche lorsque les opposants à l’euthanasie (pour ne pas dire « le droit de tuer », formulation qui aurait le mérite de dire les choses clairement) refusent d’utiliser l’obligatoire euphémisme « aide à mourir » pour parler de ce qui était au moins en l’euthanasie et le suicide dit « assisté ». On entendit ainsi le Rapporteur général de la loi, Olivier Falorni (abondamment repris ensuite par de nombreux promoteurs du texte), déclarer pour défendre son vocabulaire: « Je considère que le terme “euthanasie” a été souillé par l’histoire et que celui de “suicide assisté” crée de la confusion – avec le mot suicide. » Cette vision des choses est assez singulière: on comprend que le fait que les Nazis aient largement pratiqué l’euthanasie des vieillards et des malades ne contribue guère à nous rassurer sur la dimension « humaniste » de cette pratique, mais va-t-on cesser de parler de meurtre sous prétexte qu’ils en ont commis?
Quant à la confusion entre suicide assisté et suicide, elle laisse pantois: il est évidemment contradictoire de parler de « suicide assisté » (qui est donc déjà un euphémisme pour désigner ce qui est, en réalité, un assassinat, tout comme d’ailleurs le terme « euthanasie » qui signifie « bonne mort »?), mais il est bien clair que l’acte en débat a quelque chose à voir avec le suicide, puisque, dans ce cas, c’est le « patient » qui s’administre le poison en mettant fin lui-même à son existence, ce qui est exactement un suicide.
Le constant refus de désigner les choses par leur nom témoigne d’un rapport à la réalité pour le moins problématique. Mais le plus étrange est ce monde utopique dans lequel vivent la plupart des députés de gauche. Tout y est à peu près cohérent, mais repose sur des prémices totalement déconnectées de la réalité, qui font songer à cet aphorisme du grand Chesterton: « Le fou n’est pas l’homme qui a perdu la raison. Le fou est celui qui a tout perdu, excepté la raison. »
La nouvelle loi de la Jungle
Ainsi affirme-t-on que « l’aide à mourir » est un droit. Soit. Mais, immédiatement, une logique monstrueuse se met en branle: si c’est un droit, nul ne doit en être privé. Or, les promoteurs du texte ont refusé d’exclure explicitement les handicapés, notamment les personnes souffrant de déficience intellectuelle ou de maladie psychiatrique, au motif implacable que ce serait « discriminatoire » – crime irrémissible pour les modernes, alors que, dans le monde réel, la vie est bel et bien une succession de choix, c’est-à-dire de discriminations! Dans le même esprit, puisqu’il s’agit d’un nouveau « droit », la société aura désormais le devoir de le rendre accessible concrètement et, par conséquent, on ne tolère (momentanément, selon la fameuse théorie du « pied dans la porte »: on multiplie les précautions mais, une fois le principe acquis, les précautions tombent les unes après les autres) la clause de conscience des personnels soignants qu’à la condition expresse que les objecteurs désignent eux-mêmes celui qui fera office de bourreau. De sorte que même le médecin qui considère que l’euthanasie est un assassinat doit s’en faire le complice, sous peine de tomber sous le coup du « délit d’entrave » puni de deux ans de prison. C’est ce que Sandrine Rousseau appelle un « nouveau droit qui n’enlève rien à personne » – si n’est la conscience aux uns, et la vie à d’autres, pauvres hères qui cèdent aux injonctions ou « conseils » intéressés un jour de tristesse, qui se sont vus arracher un consentement auquel ils ont fini par consentir dans des conditions qui restent à définir…
De façon générale, il est fascinant de constater comment le désir individuel du moment est ainsi érigé en norme absolue s’imposant à tout le corps social. À ce compte, nous revenons rapidement à la loi de la jungle dont le « contrat social » rousseauiste était réputé nous avoir tiré: nos « souverainetés » individuelles sont opposées les unes aux autres, détruisant tout ce qui fonde le lien social.
Au fond, la gauche demeure ce qu’elle est depuis des siècles: nominaliste, c’est-à-dire persuadée qu’il suffit de changer la définition des mots pour changer la réalité selon ses caprices et « priorités » du moment. Ce nominalisme atteint des sommets lorsque l’on prétend que même le sexe biologique est arbitraire et peut être modifié à volonté. Pourtant, en ce domaine comme ailleurs, la réalité reprend toujours ses droits – et parfois cruellement: songeons à ce violeur qui, à la veille d’être incarcéré, annonça aux juges qu’il « se sentait » femme et demandait donc à être emprisonné avec des femmes. Quelques viols plus tard, les juges se rendirent à l’évidence et l’exfiltrèrent vers la prison des hommes. Combien de victimes devrons-nous supporter pour chasser ces nuées et revenir au réel ?