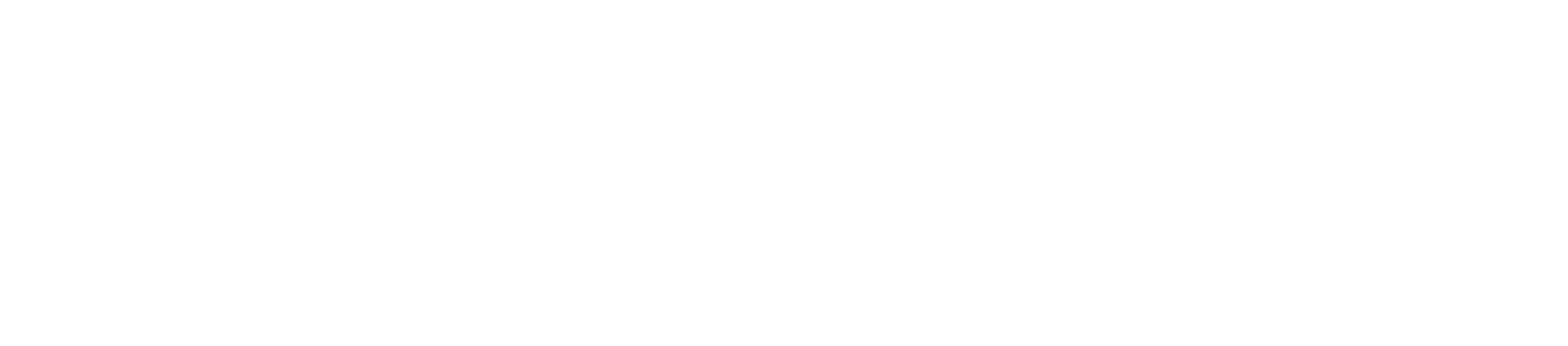Par Jean-Frédéric Poisson
L’agriculture française et, plus largement, européenne est à un tournant de son histoire. « La course aux prix », générale et mondialisée depuis plusieurs décennies, incite à la compression des charges par l’agrandissement des structures, la mécanisation, la moindre rémunération de la main-d’œuvre, voire son remplacement robotisé, l’augmentation outrancière de rendements par des techniques écologiquement douteuses… Cela entraîne partout dans le monde la paupérisation des paysans, l’exode rural, la mort des campagnes.
Les précédentes réformes de la politique agricole commune (PAC) ont modifié en profondeur le fonctionnement de l’agriculture et ses finalités. La dernière livrée 2023-2027 est marquée par la complexité et une vision court-termiste. Or, l’état présent du monde nécessite de réexaminer ce que l’on souhaite faire de notre agriculture. La crise sanitaire a mis au jour le degré élevé de la dépendance du pays envers l’extérieur pour des approvisionnements en produits de « première nécessité », comme les médicaments, les masques, certaines matières premières, et, pour ce qui est de l’agriculture, en protéines végétales (soja essentiellement) pour nourrir le bétail. Depuis l’année 2020, la problématique de la souveraineté alimentaire s’est imposée. Dans un monde instable qui a besoin de nourriture, l’agriculture française, l’une des plus performantes de la planète, qui contribue depuis de longues années à l’autosuffisance de l’Union européenne et aux grands équilibres alimentaires de l’humanité, est devenue un secteur hautement stratégique.
Son évolution et son avenir posent toutefois un certain nombre de questions. Citons pêle-mêle la baisse des effectifs d’agriculteurs, l’érosion de sa compétitivité sur les marchés, les assauts de la concurrence intra et extra-européenne (Espagne, Allemagne Pologne, Maroc, Brésil…), le discrédit jeté sur elle par une partie de la population, le manque de perspectives et, enfin, des politiques publiques de moins en moins protectrices, comparativement à d’autres nations qui soutiennent leurs producteurs. Autant de diagnostics qui suggèrent d’inverser ces tendances pour revivifier un secteur dont la population attend beaucoup en termes de quantité, de qualité et de proximité.
Que proposer ? L’agriculture est d’abord une activité humaine nécessaire aux nations et à leurs citoyens. C’est le travail de femmes et d’hommes, souvent imbriqué à une vie de famille, nécessitant un équilibre permanent avec la nature, avec tout ce qu’elle offre de durable (le cycle de la vie, le rapport au temps), mais aussi d’instable, voire de brutal, lors de certains aléas. L’agriculture est aussi porteuse d’un ancrage, d’une identité, de valeurs sociales et culturelles. Ces différents aspects disent toute son importance, bien au-delà de la capacité à nourrir un peuple. C’est pourquoi elle doit être traitée dans sa plénitude et à part, sur le plan international, comme sur le plan national ou local.
Assurer aux agriculteurs des conditions de travail attractives et une rémunération décente requiert de créer une exception agri-culturelle française, de même que la France subventionne le cinéma et la culture plus que tout autre pays ou s’enorgueillit de sa conception tout à fait spéciale de la laïcité. Cette ambition passe par une réorientation de la politique agricole commune (avec une augmentation de son budget), l’obtention d’un commissaire européen à l’agriculture, la couverture des pertes de chiffre d’affaires et le couplage des aides des exploitations agricoles. Autant d’évolutions politiques qu’un gouvernement armé d’une réelle volonté politique pourrait obtenir. Il aurait paru nécessaire d’appliquer strictement la loi EGALIM avant de lancer EGALIM 2 en supprimant les distorsions de concurrence (TVA sociale reversée directement à la MSA, refus des accords de libre-échange) et en encourageant l’installation de nouveaux entrants dans ce domaine, ce qui passe par la promotion des filières agricoles dans les écoles, les médias, les réseaux sociaux, par des aides financières uniques revalorisées en zone défavorisée, par le renforcement de l’attractivité des territoires ruraux et par l’incitation au retour d’une main-d’œuvre française en augmentant les différences de revenus entre travail et non-activité.
Pas sûr de plus que le traité Mercosur que l’Union européenne semble vouloir faire passer en force contre l’avis d’États membres et de nombre d’agriculteurs donne pleinement satisfaction en la matière !
Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la France doit veiller à établir des orientations agricoles sur une durée longue. Doivent être privilégiées certaines pratiques culturales comme l’agriculture de conservation, la sélection animale, la gestion de l’eau sur les aspects qualitatifs et quantitatifs et l’assouplissement des règles de gestion des prédateurs et des nuisibles en élevage ou en culture, afin d’alléger le coût des sinistres et le stress des exploitants. Il serait possible d’inscrire l’agriculture comme secteur prioritaire pour la production d’énergie et d’avancer vers la neutralité carbone (horizon 2050) en encourageant les filières de bioéthanol, de méthanisation agricole ou de photovoltaïque.
Tout cela vise à redonner à la France sa puissance agricole dans le monde. Dans cet esprit, le domaine de l’agriculture doit être défini comme hautement stratégique pour la nation. L’agriculture française doit être favorisée dans les négociations internationales en utilisant des clauses-miroirs. Nous devons tendre vers une autonomie alimentaire et protéique (production de pois, luzerne, maïs épis, soja en fonction des territoires, introduction d’un « plan protéines » dans la nouvelle PAC). Il est nécessaire d’appliquer strictement et sans délai l’article 44 de la loi EGALIM pour éviter l’importation de produits extérieurs à l’UE non conformes à notre réglementation communautaire, avec possibilité de les taxer, s’ils ne respectent pas nos normes. Enfin, l’incapacité des instances internationales à assurer l’accès à l’alimentation pour tous est un phénomène grave et inquiétant. Il est dû pour partie aux distorsions importantes des cours liés à la logique de marché qui prévaut partout. Faudra-t-il inventer des mécanismes de régulation économique pour que l’humanité réussisse à assurer la destination universelle des produits agricoles ?
S’il fallait définir une ambition pour l’agriculture de demain, on pourrait sans doute la résumer ainsi : l’agriculture de demain, c’est avant tout la production d’alimentation et d’énergie saines et nécessaires à la vie du peuple par une valorisation responsable et durable des territoires, en assurant un revenu décent aux exploitants et à leur famille.