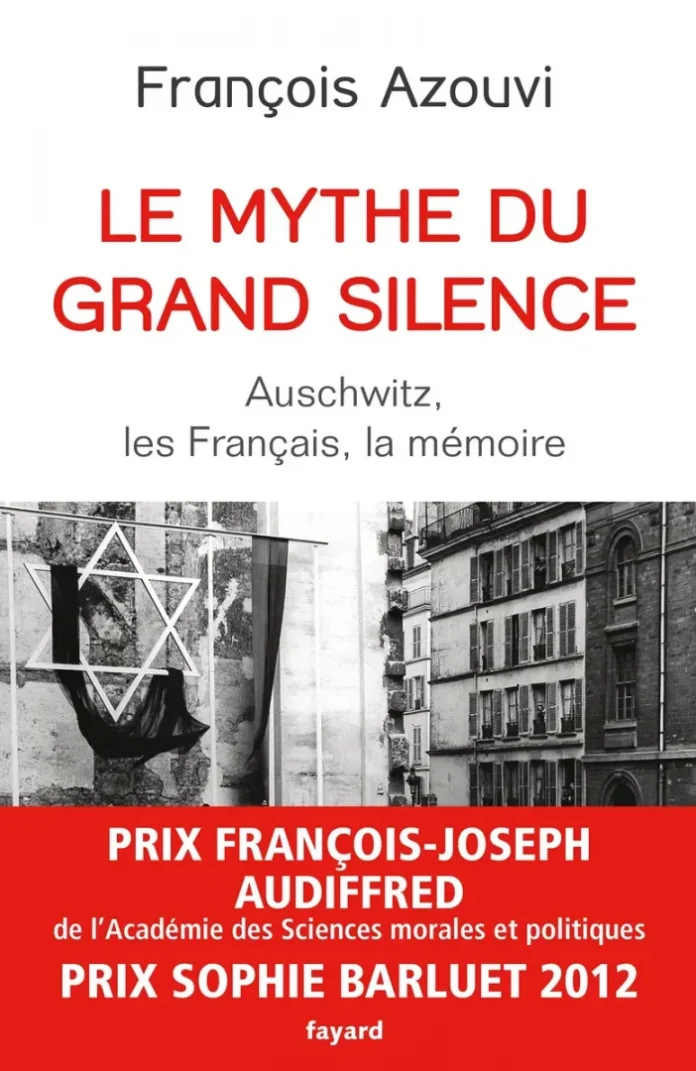Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire par François Azouvi aux éditions Fayard.
Recension de Jean-Gérard Lapacherie
La France est ou serait malade. C’est du moins ce dont les historiens bien en cour, les idéologues de la culture et les penseurs de média essaient de persuader les Français. Ceux-ci sont incités à avoir honte du passé de leur pays, un passé « qui ne passe pas », à l’oublier pour ne se rappeler que les bassesses, vilenies, infamies sans cesse rappelées. Ces discours ont un but : que la France se repente d’être ce qu’elle est et, si par hasard elle était désireuse de se faire pardonner (mais par qui ?), qu’elle cesse de vouloir continuer dans son être, qu’elle renonce à tout ce qu’elle a été, qu’elle accueille, malgré qu’elle en ait, toujours plus de peuples nouveaux, Autres, agressifs, venus de loin, qui vont effacer en deux ou trois générations ses réalités millénaires. Le destin qui lui est assigné, à elle et à son peuple, est de sortir enfin de l’Histoire pour végéter dans quelque cul de basse-fosse (l’Europe par exemple).
Le passé honteux est une des thèses du livre de François Azouvi qui a paru il y a treize ans. Alors, il a été accueilli plutôt froidement par les historiens qui, il est vrai, ont pu se sentir visés par les analyses du livre, mais qui, très vite, l’ont oublié, sous le prétexte que l’auteur, qui est philosophe, s’était aventuré sur un terrain qui n’était pas le sien. Les idéologues écrivant dans la presse l’ont détesté aussi, parce qu’il dévoilait leur grand mensonge. En 2025, ce livre est à lire ou à relire, car il fait comprendre beaucoup de réalités de notre présent – la maladie française en particulier. Le Nouveau Conservateur a publié dans la livraison n° 3 du printemps 2021 une recension d’un autre livre de François Azouvi, plus récent : Français, on ne vous a rien caché. La Résistance, Vichy, notre mémoire (2020, Gallimard). Ces deux livres se complètent et constituent une véritable hygiène de l’histoire.
François Azouvi dédie son livre à la mémoire de ses « grands-parents Elie et Mazaltov Azouvi, Drancy, convoi n° 44, 9 novembre 1942 ». Déportés en Allemagne, ils y ont été assassinés. C’est donc ce descendant de victimes de la Shoah qui tient « le grand silence » pour un « mythe ». Ce mythe consiste en ceci : au lendemain de la guerre et pendant près de trente ans, jusqu’au milieu des années 1970, les Français n’auraient pas eu connaissance (ou pas voulu en avoir connaissance) de l’extermination des Juifs entre 1939 et 1945. Plus occupés à s’étourdir dans les caves de Saint-Germain-des-Prés qu’à méditer sur le plus grand crime de l’histoire, ils auraient refoulé le génocide pour l’occulter. C’est au milieu des années 1970 que le refoulé aurait fait retour et qu’enfin, sous le nom de Shoah, les Français auraient pris connaissance du génocide des Juifs. François Azouvi démontre que ce schéma, lointainement inspiré par une psychanalyse de pacotille (traumatisme, occultation, retour du refoulé), est faux et que, dès septembre 1944, le génocide est entré dans la culture française, en particulier dans la conscience catholique. Pour cela, il a dépouillé tout ce qui a été publié à compter de la Libération de Paris et a analysé le travail d’information des journalistes, des écrivains, des essayistes, qui ont élaboré « une précoce philosophie de l’univers concentrationnaire ». Il a lu aussi les livres publiés et vu les films qui ont été réalisés entre 1944 et 1961 pour en conclure que, pendant ces quinze années de supposé « silence » ou de prétendu « refoulement », le génocide a été de très nombreuses fois « mis en film et en roman ». Trois fois de suite, dans les années 1950, un roman traitant du génocide a été couronné du prix Goncourt – ce qui, compte tenu du succès des romans couronnés, laisse penser que des millions de lecteurs en ont été informés, s’il en était besoin. Le Journal d’Anne Franck traduit en de nombreuses langues et publié dans de nombreux pays a connu un succès mondial – de sorte que le génocide a été porté, si cela était encore nécessaire, à la connaissance de plusieurs millions d’êtres humains dans le monde. Puis, à l’occasion du scandale de la pièce Le Vicaire, puis du procès d’Eichmann, enfin de la guerre des Six-Jours en 1967, le génocide a acquis une réalité publique massive. C’est dans les années 1970 que le génocide est devenu une affaire d’État (grâce accordée à Touvier, procès intenté à Klaus Barbie, commémorations diverses, mémorial) et que la contestation qui pouvait en être faite est devenue un crime. Autrement dit, la thèse accréditée par un schéma psychanalytique mécanique et formel (traumatisme, refoulement, retour du refoulé) et répétée sur tous les tons – surtout sur un ton accusatoire – dans les années 1970 est mensonge ou invention. Il n’y a pas eu de « silence ». Au contraire, et cela dès septembre 1944. La fonction de cette thèse, ce pour quoi elle a été inventée et répétée partout, est de culpabiliser les Français, de faire en sorte que ces innocents se sentent coupables, de leur faire porter la responsabilité des crimes, quitte à en exonérer en partie leurs auteurs. Il est une autre fonction dont François Azouvi ne tient pas compte. Ceux qui ont répandu le mensonge du « grand silence » ont été nourris au lait aigre du marxisme-léninisme, stalinisme, trotskisme, gauchisme, maoïsme, communisme. Après la publication de L’Archipel du Goulag, ces marxistes ne pouvaient plus rien nier ; ils avaient approuvé ces crimes, ils s’en étaient réjouis, ils étaient près de les faire subir aux Français. Alors, pour prévenir les accusations fondées de bienveillance, complicité ou silence envers ces crimes, ils les ont reversées sur la France et les Français. C’est l’inversion accusatoire à laquelle fait référence La Fontaine dans quelques fables, dont Le Loup et l’Agneau et Les Animaux malades de la peste. Elle est encore aujourd’hui l’arme favorite des négationnistes : elle a été efficace naguère. Pourquoi ne le serait-elle pas éternellement ?