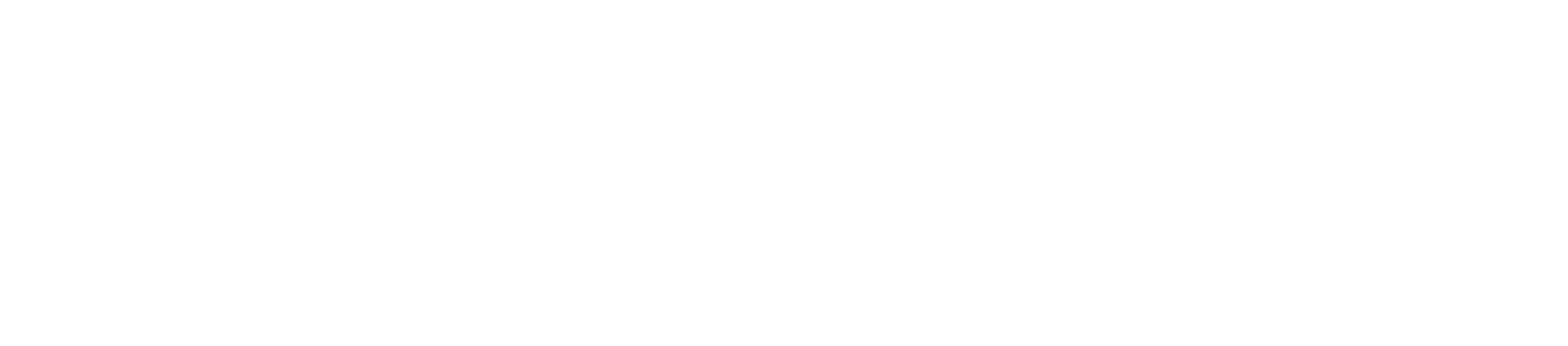Théophile Berlier. Révolutionnaire et rédacteur oublié du Code civil par Hubert de Vauplane aux éditions Michel de Maule.
Recension de Marc Hostier
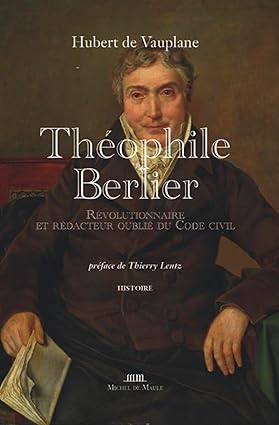
La Révolution et l’Empire révèlent encore des découvertes de parcours étonnants. Celui de Théophile Berlier en est l’illustration même. Jeune avocat en 1789, Théophile Berlier est élu député de la Côte-d’Or à la Convention nationale où, très vite, il s’impose comme l’un des piliers du comité de législation, organe qui prépare les lois visant à modifier en profondeur la société issue de l’Ancien régime, à commencer par le droit de la famille. Président de la Convention nationale, membre du Comité de salut public, puis député sous le Directoire au Conseil des Cinq-cents dont il devient aussi le président, substitut au Tribunal de Cassation, il est nommé par Bonaparte au sein du Comité de législation. Il est l’un des principaux rédacteurs du Code civil, mais aussi du Code pénal, du Code d’instruction criminelle et d’autres codes, l’artisan de nombreuses lois, comme celle sur la création des Écoles de droit après la disparition sous la Révolution des facultés de droit. Régicide, il est exilé à Bruxelles d’où il ne reviendra qu’en 1830.
La grande ambition de Berlier, c’est la réforme de la famille. Son projet est de calquer l’organisation de la famille sur les principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Si la Révolution a conduit à un changement de régime politique, elle a d’abord bouleversé la société en supprimant les ordres et en affirmant la place de l’individu. Si l’on veut examiner les transformations opérées par la Révolution sous l’angle public et domestique, on peut synthétiser celles-ci par une double réforme : celle de la propriété et celle de la famille. C’est la Révolution qui va permettre l’avènement de la propriété individuelle absolue en lieu et place de la féodalité. La réforme de la propriété a ainsi été le socle de la réforme politique : c’est parce que l’individu est pleinement et totalement propriétaire de son bien qu’il est aussi un citoyen libre disposant de droits politiques de façon égalitaire avec les autres citoyens. De la même manière pour la famille, c’est du fait que l’individu est citoyen qu’il peut se marier et divorcer librement. La Révolution a dès lors permis l’émergence d’une double démocratie : politique et familiale.
C’est en ce sens qu’il faut comprendre le rôle de Berlier sur le divorce, l’adoption, l’égalité des droits des époux, mais aussi des enfants naturels ou légitimes dans les successions, l’opposition à la puissance paternelle et, plus largement, une conception libérale du mariage. Sa participation législative sous la Convention est impressionnante. Parmi les nombreuses lois portées, présentées ou défendues par Berlier, certaines sont marquées par le sceau des événements. Ainsi en est-il de la loi sur les successions et héritages et sa rétroactivité, ou encore de la loi sur les otages, qui s’inscrit dans le fil de la loi sur les suspects. Cette dernière loi sera d’ailleurs celle qui lui portera le plus ombrage dans le futur, conduisant sans doute à ce qu’il soit écarté par Napoléon d’un certain nombre de positions et d’honneurs.
Sa participation à l’œuvre de rédaction du Code civil constitue l’un des points les importants, et sans doute même le plus significatif, de sa carrière. Berlier est le seul des différentes personnes ayant travaillé sur le Code Napoléon à avoir participé auparavant aux trois projets de Code civil de Cambacérès, mais aussi au projet de Code civil de Jacqueminot. Il dispose ainsi d’une expérience que les autres rédacteurs n’ont pas.
La carrière de Berlier a essentiellement été celle d’un légiste. Il est l’illustration des juristes contractualistes, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée : le contrat régit les relations entre les individus dans toutes leurs dimensions, parfois même au-delà des institutions. Et c’est à la loi de fixer les limites à cette liberté. De même, il fait partie de ces juristes guidés par une vision anthropologique positive, malgré l’expérience de la Terreur. Il aura maintes fois l’occasion de défendre une vision de la justice plus empreinte d’humanité.
Cependant, Berlier n’est pas un théoricien du droit. Il n’a pas rédigé de traité juridique, ni théorisé sa pensée en la matière, pas même dans ses mémoires ou ailleurs, il n’a pas proposé de systèmes ou de doctrines. Et pourtant, toute son action législative est guidée par une conception du droit qui lui est propre, par une vision juridique personnelle, par une doctrine de la loi qu’il a élaborée au fur et à mesure de son expérience. Il faut ainsi aller rechercher dans ses différentes interventions au cours des discussions parlementaires à la Convention nationale ou au Conseil des Cinq-Cents, lors des débats au sein du Conseil d’État, puis dans les articles juridiques qu’il a rédigés dans l’Encyclopédie moderne sous la Restauration pour essayer de cerner sa pensée. De ce point de vue, il est frappant de constater qu’entre ces trois périodes s’étalant sur une trentaine d’années et marquées par de profonds bouleversements, la pensée juridique de Berlier n’a pas drastiquement changé. Il garde une vision anthropologique positive de l’homme et reste un partisan du contrat, encadré par la loi.
Comment considérer Berlier à la fin de sa vie politique ? Il est le seul des juristes jacobins à être resté fidèle aux idéaux de l’an II et de ne pas avoir sacrifié tout ou partie de la législation révolutionnaire qu’ils avaient promue. Jusqu’au bout, il défend ses convictions, notamment pour son vote pour la mort de Louis XVI qu’il ne reniera jamais, quitte à rester bloqué dans son exil à Bruxelles. Plusieurs fois, il s’oppose à Bonaparte : sur la question de la Légion d’Honneur, sur le consulat à vie, sur l’Empire, sur le retour des émigrés, sur le jury populaire, sans compter ses prises de position lors des débats sur le Code civil. Dernier des Jacobins du Conseil d’État et alors que l’Empire s’effondre, il s’oppose encore à Merlin de Douai et Cambacérès lorsque ceux-ci tentent de rétablir le système des rentes au détriment de l’abolition de la féodalité, acquis primordial de la Révolution. L’historien américain Woloch, dans son ouvrage Napoléon and his collaborators, considère que cette fidélité à ses convictions est ce qui caractérise Berlier.
Berlier fait partie de ces juristes révolutionnaires qui par leurs actions et leur rôle de légiste tout au long de la Révolution et de l’Empire ont forgé le compromis politique et social entre l’Ancien Régime et la Révolution. Ils ont préparé le courant politique des républicains modérés qui se développera tout au long du XIXe siècle.
La biographie de Berlier est divisée en deux parties. La première relate sa vie, des débuts de la Révolution à son retour d’exil en 1830. Elle s’appuie sur ses Mémoires, publiées hors commerce à titre d’auteur en quelques exemplaires seulement, mais disponibles à la BnF. La seconde partie traite du rôle de Berlier dans les grandes lois révolutionnaires, puis dans la rédaction du Code civil et celle du Code pénal et d’instruction criminelle.
Achetez le dernier numéro du Nouveau Conservateur.
Achetez Théophile Berlier. Révolutionnaire et rédacteur oublié du Code civil par Hubert de Vauplane aux éditions Michel de Maule.